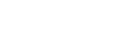Il est rare qu’une querelle vienne secouer le champ académique français. Alors que la France a connu des discussions passionnées au moment des querelles du panthéisme et de l’animisme dans les années 1850 (autour de la psychologie de Cousin), des batailles sur la laïcité dans les années 1900 (à partir de la sociologie de Durkheim) ou de la querelle du structuralisme et de l’humanisme dans les années 1960 (dont l’anthropologie de Lévi-Strauss était l’occasion), on peut remarquer que les dernières grandes querelles intellectuelles nous viennent de l’étranger : « l’affaire Sokal » sur les rapports entre science et littérature, en provenance d’Amérique, ou la polémique suscitée par la conférence de Sloterdijk sur l’usage moral des biotechnologies, venue d’Allemagne – comme si le champ académique français avait perdu la capacité d’interrogation qui lui permet de se quereller de l’intérieur de lui-même.
C’est ce que semble confirmer une nouvelle querelle qui nous vient de Suisse, et d’une discipline jusque-là connue pour sa discrétion et sa politesse : la sinologie. Résumons brièvement la situation : le grand représentant de l’école de sinologie de Lausanne, Jean-François Billeter, attaque le plus éminent des sinologues parisiens dans un ouvrage dont le titre, Contre François Jullien, rappelle la violence polémique d’un Proust (Contre Sainte-Beuve), voire celle des grandes controverses théologiques (Tertullien, Contre Hermogène, Origène, Contre Celse…). Et voici que les grands noms de la sinologie, de la psychanalyse et de la philosophie parisienne soutiennent l’accusé dans un ouvrage dont le titre, Oser construire, Pour François Jullien, dramatise encore l’enjeu, en en faisant l’occasion d’un nouvel élan pour la pensée occidentale. Dans sa structure historique et géographique, cette querelle s’apparente à celle qui avait opposé Jean-Jacques Rousseau à l’establishment intellectuel parisien, lorsque le philosophe genevois, critiquant la civilisation au nom de l’état de nature, se voyait accusé par les amis de Voltaire de vouloir revenir à la sauvagerie – le consensus des intellectuels parisiens contre le sinologue suisse ressemblant fortement à l’unanimité des philosophes des Lumières contre le pauvre Jean-Jacques. Mais alors que le xviie siècle se querellait autour de l’effet des sauvages sur une civilisation qui les avait découverts trois siècles plus tôt, notre xxie siècle commençant se querelle à propos de l’effet de la Chine sur une philosophie européenne qui l’a découverte trois siècles auparavant, et qui n’a pas fini d’en tirer les conséquences — comme si la philosophie subissait avec un retard qui lui est propre l’effet du « choc des civilisations ». Peut-être en effet l’explosion actuelle de la société chinoise et le défi qu’elle lance au capitalisme globalisé la conduira-t-elle à prendre dans l’imaginaire occidental la place qu’occupaient jusque-là « les sociétés sauvages », avec la même capacité à susciter des débats théoriques qui rejouent, à l’occasion de la rencontre avec l’exotisme, les grandes catégories de la pensée occidentale.
Qu’a donc fait François Jullien pour qu’un éminent sinologue puisse ainsi l’attaquer ouvertement ? Depuis vingt ans, François Jullien a constitué, au fil d’une vingtaine d’ouvrages, une œuvre impressionnante fondée sur la comparaison de la pensée occidentale et de la pensée chinoise. Agrégé de lettres classiques, il est parti en Chine dans les dernières années du maoïsme en vue d’interroger une pensée qui ne procède pas de façon franche en exposant les arguments contradictoires pour en dégager la vérité, mais de façon allusive, détournée, de façon à faire émerger une parole efficace dans une situation : ainsi de cet énoncé qui conclut la Révolution culturelle selon lequel « la pensée de Mao Zedong est vraie à 70 % », indiquant qu’on pouvait commencer à critiquer le maoïsme sans craindre les représailles du régime. François Jullien a étudié aux universités de Shanghai et Pékin de 1975 à 1977, où il a rédigé une thèse sur le grand écrivain dissident de la première République chinoise Lu Xun, puis il fut conseiller culturel à Hong Kong de 1978 à 1981, où il fonda l’Antenne française de sinologie dans un lieu encore situé hors de la République populaire de Chine et commode pour en observer les évolutions, avant d’étudier au Japon entre 1985 à 1987, où les grands historiens des années trente ont constitué une somme documentaire inestimable sur la Chine archaïque et impériale.
Depuis son retour à Paris en 1989, il a fait connaître la sinologie à un large public grâce à des livres faciles d’accès, traduits dans une dizaine de langues, et notamment en Asie où ils suscitent de nombreux débats. Il est par ailleurs professeur de sinologie à l’Université Paris VII et a été président du Collège international de philosophie de 1995 à 1998, puis directeur de l’Institut de la pensée contemporaine ; chacun de ses livres fait l’objet d’une chronique développée dans Le Monde (en général par Philippe Sollers ou Roger-Pol Droit) et sa démarche est au centre de plusieurs numéros du Débat. Bref, François Jullien est un intellectuel français de niveau international, et c’est cette influence que Jean-François Billeter veut interroger, en la rappelant à sa « responsabilité », c’est-à-dire en examinant son efficacité dans la France et la Chine d’aujourd’hui.
François Jullien a une influence considérable, et donc une responsabilité. Cette influence me paraissant en grande partie néfaste, j’ai voulu le faire savoir
commence abruptement Jean-François Billeter dans Contre François Jullien (p. 7).
Avant d’exposer les arguments de Jean-François Billeter, il faut rappeler la méthode suivie par François Jullien au fil de ses livres. Cette méthode est toute entière annoncée dans son premier livre, paru en 1985 d’après sa thèse, La valeur allusive, sous titré : Des catégories générales de l’interprétation poétique dans la tradition chinoise (Contribution à une réflexion sur l’altérité culturelle). À travers une réflexion sur la poésie, le propos est d’examiner le processus intellectuel à son point de plus haute intensité, tel qu’il a été thématisé par les Grecs, Platon et Aristote notamment, comme une saisie du poète par le divin sous le coup de l’inspiration. Mais au lieu d’interroger ce processus poétique par un recul en arrière vers les pré-socratiques, à la manière de Martin Heidegger ou de Jean Bollack, il s’agit de faire un pas de côté pour en examiner les équivalents en Chine.
Pourquoi la Chine ? François Jullien s’est souvent expliqué sur ce parti pris méthodologique : il s’agissait de trouver un continent de pensée qui n’ait rien en commun avec l’Occident, c’est-à-dire qui n’ait pas eu de contact avec les Européens avant une date récente – ce qui excluait l’Inde et les sociétés indo-européennes. Mais il ne s’agissait pas non plus de revenir à une société archaïque comme ont pu l’être les présocratiques pour Heidegger ou les sociétés primitives dans l’anthropologie durkheimienne, renvoyant à l’origine de notre société. La particularité de la Chine est en effet que sa tradition, constituée dans les dix premiers siècles avant notre ère, s’est transmise avec une grande continuité jusqu’au siècle dernier – et opère même, après ce que certains interpréteront comme une parenthèse communiste, un étonnant retour dans la Chine d’aujourd’hui – en sorte qu’on peut la comparer comme un bloc de pensée homogène aux textes de notre tradition, qui de ce fait apparaissent, malgré leurs différences internes, comme liés eux-mêmes par des présupposés communs. Pour désigner cette méthode comparative, François Jullien emprunte à Michel Foucault, qui reprend à Borges son Encyclopédie chinoise fictive dans les premières pages des Mots et les choses, le terme d’« hétérotopie », désignant la confrontation de blocs de pensée géographiquement éloignés provoquant un ébranlement critique de la réflexion. La rencontre de la Chine joue alors, chez Jullien comme chez Foucault, un rôle analogue à la découverte de l’empirisme sceptique de Hume par Kant : une sortie du sommeil dogmatique et une interrogation de la pensée depuis ses limites, en quoi se définit le plus spéculativement l’activité critique.
La démarche de François Jullien consiste donc à pousser la sinologie à sa limite, en interrogeant sa connaissance de la Chine depuis les catégories occidentales qui permettent d’en parler, en même temps qu’elle pousse la philosophie occidentale à sa limite, en la confrontant à cette pensée chinoise qu’elle a toujours laissée hors de son domaine. Il s’agit d’inventer, selon la formule provocatrice de La valeur allusive, « une sinologie qui soit vraiment occidentale » (p. 4), c’est-à-dire qui assume que le discours sur la Chine soit celui de l’Occident lorsqu’il s’interroge sur ses propres limites. La sinologie n’est donc pas aux yeux de François Jullien une science dotée de ses propres objets et de ses propres méthodes, mais le point de départ d’une démarche critique sur la pensée occidentale, pour la raison suivante : la Chine n’est pas un objet comme un autre, mais elle est, pour l’Occident, « l’altérité » culturelle par excellence. Du fait qu’elle possède une tradition intellectuelle de plusieurs millénaires qui n’a rien emprunté à l’Occident, la Chine lui offre un miroir dans lequel celui-ci peut voir toutes ses catégories déformées, ne se reconnaissant qu’au terme d’une aliénation qui constitue une véritable expérience de pensée. L’effroi du sinologue devant l’immensité du bloc de pensée qu’il doit étudier est donc l’occasion d’un exercice intellectuel permettant de faire de cette altérité irréductible le moteur d’un travail sur soi, qui définit les « sciences humaines » comme activité critique.
Pourquoi la sinologie doit-elle représenter pour l’esprit occidental une « aliénation » (au sens propre du terme, à moins de rêver à sa propre sinisation) ? Et pourquoi la sinologie ne pourrait-elle aboutir à une production théorique qui intéresse directement les sciences humaines et puisse contribuer à répondre à nos interrogations – ou du moins à les mieux comprendre ? Pourquoi ne servirait-elle pas, tout simplement, à nous exercer à penser ?
La valeur allusive, p. 8-9
Il ne s’agit pas de « devenir chinois », ni même de « penser comme un Chinois », mais de penser à la limite entre l’Occident et la Chine, dans l’événement même que la confrontation entre ces deux blocs de pensée a constitué au seuil de la modernité. (Voir le livre classique de Jacques Gernet, Chine et christianisme, la première confrontation, Paris, Gallimard, 1982.).
De fait, la méthode de François Jullien est un curieux mélange de style chinois et de style occidental. D’un côté, il pratique lui-même ce détour qu’il dit caractéristique de la pensée chinoise (voir Le détour et l’accès, Stratégies du sens en Chine et en Grèce, 1995) en passant incessamment de l’Europe à la Chine et de la Chine à l’Europe (sous le terme d’Occident il entend en effet exclusivement l’Europe, et même l’Europe de l’Ouest, laissant de côté ces détours internes à l’Occident qui passent par les Etats-Unis ou l’Europe de l’Est). De même, il commente les textes classiques de la Chine ancienne (comme le Yi Jing ou « Classique du changement » dans Figures de l’immanence, 1993), à la manière des lettrés chinois, en le mettant en rapport avec d’autres textes de la tradition chinoise qui en éclairent le fonctionnement, mais aucun texte n’est abordé pour lui-même dans sa totalité désignée par un nom d’auteur. Chacun des livres de François Jullien procède à une interrogation sur une grande catégorie occidentale (la poésie, le sens, l’esthétique, l’efficacité, la morale, l’essence, le temps, le mal, le bonheur, le langage…) et tisse les textes de la tradition européenne avec ceux de la tradition chinoise au fil d’une réflexion qui ne s’arrête sur aucune conclusion définitive, sinon sur le présupposé méthodologique selon lequel la Chine a pris un autre point de départ que l’Occident dans sa pensée.
Pour désigner le fond commun qui lui permet ainsi d’articuler penseurs européens et penseurs chinois, François Jullien emprunte à Gilles Deleuze la notion de « pli », qui lui permet d’éviter la métaphore du fossé entre deux blocs de pensée séparés, et désigne un tissu commun qui, en se pliant, a pris des formes différentes, mais que l’on peut déplier et replier autrement en vue d’une interrogation renouvelée sur les conditions même de la pensée. Si l’on désire suivre au plus près l’étoffe des textes chinois et occidentaux, il faut une véritable souplesse mentale, apparentant la lecture des ouvrages de François Jullien à un exercice de gymnastique, comme ces pas de Taiji Quan que les Chinois font le matin dans les jardins publics, en enchaînant presque sans y penser des postures apparemment répétitives mais qui ne varient que dans l’intensité de l’intention et de l’enchaînement.
D’un autre côté, la démarche de François Jullien reprend les traits les plus évidents de la pensée occidentale, en ce qu’elle oppose de façon brutale des termes antinomiques pour dégager de cette confrontation une conclusion. Chacun des livres de François Jullien est en effet construit sur une antinomie : incitation contre inspiration, détour contre accès, procès contre création, immanence contre transcendance, mal contre négatif… La pensée chinoise est en effet décrite par François Jullien comme une pensée qui ne sépare pas l’homme de la nature par une volonté qui lui serait propre, mais le réinsère dans un processus immanent dont il prolonge poétiquement le mouvement. En cela, la Chine apparaît comme une de ces figures nietzschéennes (on se souvient que Zarathoustra était oriental) qui permettent d’opposer aux méfaits de la transcendance les bienfaits de l’immanence. Mais François Jullien ne va pas jusqu’à donner raison à la Chine contre l’Occident : il soutient à plusieurs reprises que la Chine, parce qu’elle ne dispose pas des ressources de la transcendance, ne peut penser la liberté et les droits de l’homme, ce qui confine à un déterminisme culturel très douteux (le concept de droits de l’homme a bien été traduit en chinois au dix-neuvième siècle, le problème étant de lui trouver un équivalent dans le riche tissu notionnel dont disposait la Chine). Au terme de la confrontation, c’est donc bien l’auteur, François Jullien, qui apparaît comme arbitre des oppositions, rappelant la radicalité de sa démarche et le travail critique qu’elle oblige incessamment à relancer – ce qui va bien à l’encontre du commentaire chinois qui implique de s’effacer devant la répétition des textes classiques.
Cette tension entre la souplesse dans le filage des textes et la brutalité dans l’opposition des traditions, François Jullien ne parvient à la résoudre que par la grâce d’un style, qui articule les concepts dans une prose fluide, dissolvant ainsi la netteté de leurs contours dans un mouvement de pensée que l’on suit irrésistiblement. Ici la référence est à nouveau Deleuze : la philosophie est une activité de création de concepts, et le mouvement de la pensée est un mouvement vivant, porté par l’intensité d’un style. De fait, chacun des livres de François Jullien invente de nouveaux concepts à partir de la traduction d’un terme chinois — comme « la fadeur » à laquelle il donne un véritable statut de concept dans Éloge de la fadeur (1993) — en sorte qu’au bout de vingt livres on ne sait plus bien quel concept retenir pour continuer le travail critique qu’il encourage à faire. Dans ses derniers travaux, François Jullien parle plutôt d’un « organon de la pensée » ou d’un « lexique euro-chinois de la pensée » — peut-être en référence au Vocabulaire européen des intraduisibles de Barbara Cassin, qui publie les ouvrages de François Jullien dans la collection qu’elle dirige avec Alain Badiou au Seuil — mais on peut se demander si une telle liste de termes n’est pas à nouveau soumise à l’objection de rhapsodie que Kant adressait à Aristote. Bref, la pensée de François Jullien, du fait de son parti pris méthodologique de se situer sur la limite entre la Chine et l’Europe, était prisonnière d’une tension interne dont elle ne pouvait se défaire qu’au prix d’un mouvement incessamment relancé qui s’apparentait à une course dans le vide.
C’est à ce point où la tension interne de l’œuvre produit non plus un intérêt intellectuel mais une fuite en avant, que se justifie l’intervention de Jean-François Billeter rappelant à François Jullien sa « responsabilité ». Il ne s’agit nullement là d’un « rappel à l’ordre » depuis la rigueur de la sinologie de celui qui s’était aventuré sur les terres de la philosophie, mais d’une authentique discussion sur les fondements intellectuels de la discipline qui a pris la Chine pour objet. Jean-François Billeter, de douze ans son aîné (il est né en 1939) a en effet développé son œuvre de sinologue parallèlement à celle de François Jullien, mais en partant de tout autre présupposés méthodologiques.
Après avoir vécu à Pékin de 1963 à 1966 et étudié au Japon dans les années 1970, Jean-François Billeter a fait sa thèse sur un lettré chinois du seizième siècle, Li Zhi, sous le titre Li Zhi, philosophe maudit (1527-1602). Contribution à une sociologie du mandarinat de la fin des Ming, publiée à Genève en 1979. Dans cet ouvrage, très influencé par la sociologie de l’éducation de Pierre Bourdieu, Jean-François Billeter étudie la figure des lettrés chinois, pour lesquels il conserve le terme de « mandarin » forgé par les premiers observateurs portugais au seizième siècle (de mandare, ordonner), à travers un personnage qui en a été l’un des critiques les plus virulents, réfugié dans un monastère bouddhiste après avoir démissionné de façon spectaculaire de la fonction publique, qu’il avait exercée dans plusieurs provinces chinoises au terme de concours de recrutement éprouvants. Dans la perspective de Billeter, le « lettré » n’est pas seulement un homme qui conserve la tradition en la reproduisant sous forme d’allusions (ce qui était la perspective de Jullien), mais c’est aussi un fonctionnaire payé par l’État pour garantir la stabilité de l’empire, et qui peut, dans des circonstances exceptionnelles, exercer une activité critique. Ainsi Li Zhi mobilise-t-il, dans son Livre à brûler (1590), des citations de Confucius contre l’interprétation moralisante qu’en donnent les « mandarins », ce qui l’a condamné à la censure avant sa redécouverte trois siècles plus tard. Billeter a poursuivi cette démarche en l’appliquant au philosophe Zhuangzi qui a vécu au deuxième siècle de notre ère, et dont les propos restent énigmatiques dans la tradition chinoise (on le rattache au courant taoïste, constitué en opposition au confucianisme par son exaltation du processus vital au détriment des obligations morales, mais son œuvre ne peut être considérée comme fondatrice du courant qui se rattache aux ouvrages de Laozi).
Billeter fait fondamentalement un travail de traducteur, en montrant que les énoncés les plus énigmatiques de Zhuangzi (notamment sur le « Dao », qu’on traduit en général par « voie » ou qu’on laisse en pinyin) peuvent se comprendre aisément si on les replace dans les saynètes de la vie ordinaire où elles apparaissent (Billeter cite abondamment Wittgenstein). Ainsi,
dans un dialogue imaginé par le philosophe Tchouang-Tseu (Billeter cite les philosophes chinois en prononciation occidentale et non en pinyin, transcription officielle du chinois en alphabet latin), Confucius voit un nageur s’ébattre à son aise dans des eaux tumultueuses et lui demande ensuite, littéralement : « As-tu un tao de la nage ? » Le sinologue peut traduire par « As-tu une Voie de la nage ? » mais aussi plus simplement par « Pour nager ainsi, as-tu une technique ? »
(Contre François Jullien, p. 50-51)
Par la voie modeste et patiente de la traduction, Jean-François Billeter en arrive ainsi à contester de l’intérieur de la sinologie une démarche qui exoticise la Chine comme une entité mystérieuse en maximisant les écarts de traduction entre la langue chinoise et la nôtre.
Cette démarche conduit Jean-François Billeter à attaquer la méthode de François Jullien sur trois fronts, qui constituent les trois chapitres de son pamphlet : « La Chine », « La philosophie », « L’immanence ». Le premier argument développé par Billeter consiste à replacer la méthode de Jullien dans un contexte plus large, celui du rapport des intellectuels français à la Chine depuis trois siècles. Dire que la Chine est « autre » mais que nous pouvons en saisir le sens si nous nous débarrassons de nos catégories de transcendance pour entrer dans les sinuosités de la pratique chinoise, cela peut paraître très nouveau dans le contexte post-maoïste de la France des années 1990, mais c’est en fait la reprise d’un très vieux thème, apparu avec les premières Lettres édifiantes et curieuses des jésuites européens envoyés en Chine, et que Voltaire a popularisées en les moquant.
Que la Chine ignore le concept d’un Dieu transcendant alors que toutes ses pratiques sont imprégnées d’un esprit de régulation, c’est ce qui avait provoqué l’admiration à la fois des Jésuites et de Voltaire : les premiers, parce qu’ils y voyaient la base d’une conversion aisée de l’empereur au christianisme (il ne leur manquait plus que le concept de Dieu pour harmoniser leur conception du monde), le second parce qu’il y voyait la possibilité d’une société ordonnée sans Dieu ni prêtres sous la direction d’un empereur éclairé. Dans les années 1820, Humboldt et Abel-Rémusat s’interrogeaient, au fil d’une longue correspondance rééditée par Jean Rousseau et Denis Thouard, sur les singularités de la langue chinoise, qui est dépourvue de grammaire et pourtant extraordinairement complexe et subtile. Au milieu du dix-neuvième siècle, Auguste Comte confia à son disciple Pierre Laffitte la rédaction des Considérations sur l’ensemble de la civilisation chinoise (1861) pour confirmer ses vues selon lesquelles la « race jaune » monothéiste, où s’étaient particulièrement développées les fonctions actives, pouvait servir de transition entre les « races noires » fétichistes, où les fonctions affectives étaient prépondérantes, et la « race blanche » récemment passée au stade positiviste, en notant le rôle de la conception confucianiste du « Ciel » dans la régulation du consensus social. À l’aube de la Première Guerre Mondiale, Victor Segalen effectua pour la marine française plusieurs enquêtes aventureuses et séjours d’étude en Chine, où il rédigea son Essai sur l’exotisme, publié de façon posthume en 1978 ; le grand sinologue Simon Leys (alias Pierre Ryckmans) lui emprunte sa conception de l'« altérité chinoise » comme « réalité savoureuse »
(voir ses Essais sur la Chine, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 757-767, et son entretien au Magazine Littéraire, n° 455, juil.-août 2006 : « La civilisation chinoise présente l’irrésistible fascination de ce qui est totalement « autre », et seul ce qui est totalement « autre » peut inspirer l’amour le plus profond en même temps qu’un puissant désir de le connaître. Je ne pense pas que l’erreur de Jullien ait été (comme le croit Billeter) d’avoir pris pour point de départ « l’altérité » de la Chine. Celle-ci, loin d’être un mythe, est une réalité savoureuse. »)
De cette image de la Chine comme « autre » qui peut régénérer l’Occident en lui offrant la conception harmonieuse de la pratique dont elle a besoin tout en manquant de la science théorique qui est l’invention propre de l’Occident, dont l’ouvrage dirigé par Michel Cartier, La Chine entre amour et haine, rappelle les figures, et dont le travail de Jullien présente selon Billeter une nouvelle configuration, il faut comprendre les raisons ; car il y avait d’autres figures d’altérité au seuil de la modernité (celles du fou, du primitif, de l’enfant, de l’animal) tout aussi fascinantes pour inquiéter la raison occidentale en cours de consolidation. Billeter en donne un élément central, qui lui vient de son travail sur Li Zhi : la Chine fascine les Occidentaux parce qu’elle est une société d’intellectuels au service d’un pouvoir impérial imprégnant si profondément la société qu’il n’a plus besoin de se manifester. Si l’influence de l’empereur sur ses sujets est analogue à celle du vent sur les feuilles d’herbe, qui ploient sans en prendre conscience, selon l’image fondamentale que Jullien analyse dans La valeur allusive, c’est parce que les ordres de l’empereur prolongent une régulation qui se produit dans la nature, et se diffusent dans la société à travers les adaptations qu’en donnent ses fonctionnaires. Un pouvoir sans Dieu c’est aussi un pouvoir sans roi : pur pouvoir de l’intellect qui se produit en harmonie avec l’ordre de la nature et en régulant inconsciemment les pratiques. On comprend alors que les intellectuels français des deux derniers siècles, au moment où ils tentaient de construire une société fondée sur l’éducation, aient été fascinés par une Chine qui avait réalisé un tel projet depuis deux millénaires — en particulier les concours de recrutement des fonctionnaires mis en place sous la Révolution Française sur le modèle de la Chine traditionnelle.
De ce fait incontestable, Billeter tire une conséquence qui l’est moins : que la fascination des intellectuels français pour la Chine tient à leur adhésion inconsciente à l’idéologie chinoise, qu’il qualifie, en reprenant le terme à Montesquieu, de « despotisme impérial », c’est-à-dire un système de règles qui ne laisse aucune liberté à l’individu (voir la quatrième de couverture de Contre François Jullien : « Ce que nous considérons aujourd’hui comme la « civilisation chinoise » est intimement lié au despotisme impérial »). En somme, les intellectuels français ne seraient fascinés par l’altérité de la Chine que parce qu’elle leur renvoie le miroir d’un pouvoir omniprésent qu’ils auraient inconsciemment refoulé, l’altérité leur étant, selon la leçon de Freud, interne et non externe. Cette attaque contre les intellectuels français ne serait pas si violente si elle ne concernait pas, dans le même mouvement, les intellectuels chinois. François Jullien prolonge en effet, selon Jean-François Billeter, une tendance propre à la pensée chinoise du vingtième siècle, consistant à se réinventer une tradition pour donner une légitimité au pouvoir en place. En témoigne la proximité entre la démarche de Jullien et celle du philosophe Mou Zongsan, réfugié à Hong Kong puis Taïwan après l’avènement de la République populaire de Chine, et qui entreprit une vaste comparaison entre la pensée chinoise et la pensée occidentale, dont beaucoup d’observateurs s’accordent à reconnaître qu’il est une des bases du « néo-confucianisme » par lequel le Parti Communiste espère réguler la société chinoise.
La colère de Jean-François Billeter concerne donc autant la France que la Chine, partageant un climat de restauration post-maoïste dont François Jullien est le principal porte-parole, sinon l’idéologue. À travers l’idée d’une « pensée chinoise » radicalement autre que la « pensée occidentale », c’est la schizophrénie des intellectuels français qui est exaltée, fascinés par un système qui « marche » tout en gardant pour eux-mêmes leurs préjugés libéraux, en même temps que l’agressivité d’une Chine qui refuse la liberté occidentale au nom d’une tradition entièrement réinventée.
Les ouvrages de François Jullien (…) ont plu parce qu’ils ressuscitaient le mythe d’une Chine « philosophique » cher aux intellectuels formés au moule de l’université républicaine et laïque. Ils ont séduit ces mêmes intellectuels parce qu’ils leur procuraient rapidement l’illusion de pouvoir faire rapidement le tour de cette Chine. (…) Beaucoup de ses lecteurs s’enferment dans une ignorance prétentieuse qui rend impossible un éventuel dialogue avec des citoyens chinois. François Jullien ne pratique lui-même pas ce dialogue. Il ne fait jamais la plus petite allusion aux débats qui ont lieu en Chine aujourd’hui. Il œuvre, contre son gré peut-être, dans le sens de l’enfermement mental auquel travaillent en ce moment, de leur côté, les forces de la restauration idéologique chinoise.
Contre François Jullien, p. 42-44
Comment instaurer les bases de ce dialogue entre citoyens européens et chinois que Jean-François Billeter appelle de ses vœux, et qui se trouve selon lui barré par l’œuvre de François Jullien ? À travers un travail de traduction qui montre les ressemblances entre la pensée chinoise et la nôtre. C’est le deuxième argument de Billeter : Jullien construit un mythe de l’altérité chinoise parce qu’il exagère des difficultés de traduction qui peuvent être levées par un travail de contextualisation. Le meilleur exemple en est le concept de « Dao » au cœur du Dao dejing de Laozi, ouvrage fondateur du taoïsme, et dont Billeter a montré, dans ses études sur Zhuangzi, qu’on pouvait en donner plusieurs traductions pour en faire saisir le sens dans chacune des saynètes de la vie quotidienne. Un autre exemple est le mot « tan », que Jullien traduit par "fadeur" et auquel il donne le statut de véritable concept, porteur de toute une esthétique alternative à la nôtre, dans Éloge de la fadeur :
Dans les textes qu’il cite, il rend uniment le mot « tan » par « fade » ou « insipide », alors que, dans la plupart des cas, il eût été plus juste de le rendre par fin, léger, délicat, subtil, imperceptible, ténu, atténué, dilué, délavé, pâle, faible, raréfié. Pour signaler dans chacune de ses traductions la notion (ou la valeur) qui lui importe, il enfonce partout, comme un clou, la traduction française à laquelle il s’est arrêté – et crée par là un effet d’étrangeté artificielle. Dans la plupart des cas, il pouvait rendre le passage de manière beaucoup plus naturelle, avec la conséquence qu’il semblerait moins chinois et nous rappellerait ce que nos auteurs ont aussi dit. C’est ainsi que l’exotisme naît bien souvent, chez François Jullien et chez les sinologues en général, d’un choix de traduction contestable.
Contre François Jullien, p. 49-50
Contre cette conceptualisation exoticisante des termes chinois, Billeter propose de valoriser non le mot mais la phrase, en respectant ainsi davantage la tournure propre à la langue chinoise, qui est profondément idiomatique, et non, comme l’allemand par exemple, conceptuelle. On accède ainsi, tout en restant dans la matière textuelle qui est le seul objet du sinologue, à la vie quotidienne des individus, par laquelle ils peuvent éventuellement résister au pouvoir impérial codifié par les lettrés.
Ceci conduit Jean-François Billeter à une troisième critique : sous le terme d’immanence, qui peut donner une vision enchantée d’un processus d’action échappant au jugement transcendant d’un souverain, François Jullien ne fait que reconduire une idéologie impériale visant entièrement l’imposition d’une hiérarchie aux individus. La notion d’immanence est en effet très floue si elle est seulement opposée à la transcendance d’un Dieu créateur ; mais elle devient plus claire lorsqu’elle est rapportée au fonctionnement d’un pouvoir qui a besoin pour se perpétuer que ses sujets soient inconscients des règles auxquels ils se soumettent, selon une analyse que Billeter rapporte au thème de la « servitude volontaire » chez La Boétie. En valorisant les puissances efficaces de l’immanence, en écho aux discours des entrepreneurs français ou chinois (ou les deux, comme André Chieng, homme d’affaires auteur d’une présentation de sa pensée à usage des chefs d’entreprise), Jullien ne ferait ainsi que prolonger le mouvement par lequel le pouvoir se justifie lui-même en montrant sa régularité interne — selon une analyse qui se rapproche de celles de Michel Foucault sur le « biopouvoir » ou de Luc Boltanski et Ève Chiappello sur le « nouvel esprit du capitalisme ».
À force de faire l’éloge de cette pensée captive qui ne s’applique qu’aux moyens, aux méthodes et aux manœuvres, et qui est donc avant tout soucieuse d’efficacité, François Jullien s’est peu à peu découvert des affinités avec les hommes d’affaire. Il s’est aperçu qu’il pouvait leur présenter une philosophie chinoise de l’Efficacité qui leur révélait leur propre pensée et leur permettait d’en assumer toutes les conséquences puisqu’elle se trouvait soudain dotée de lettres de noblesse aussi flatteuses qu’inattendues. Il a développé cela dans La Propension des choses et dans son Traité de l’efficacité. (…) On y voit apparaître pleinement la parenté entre la pensée chinoise de l’adaptation incessante aux situations et la pratique des chefs d’entreprise, qui consiste à s’adapter continuellement aux transformations du marché. On voit qu’elles reposent l’une et l’autre sur l’acceptation d’un système donné et sur la finalité qui est inscrite en lui : la lutte pour le pouvoir d’un côté, la recherche du profit de l’autre. Elles ne posent jamais, ni la véritable question des fins, ni par conséquent les vraies questions morales. Elles ne connaissent de moralité que soumises au système.
Contre François Jullien, p. 68
Qu’est-ce qu’une moralité non soumise au système ? C’est selon Billeter la résistance de l’individu au pouvoir qui tente de l’assujettir. De cette résistance toutes les sociétés humaines donnent des exemples : celle de Li Zhi lorsqu’il démissionne de la fonction publique, se rase la tête et entre dans un monastère bouddhiste, celle de Zhuangzi lorsqu’il refuse de pleurer à la mort de sa femme selon les règles de la bonne société confucianiste et joue du tambour sur son ventre devant un visiteur étonné. Il y a unité de l’expérience humaine à ce niveau vital où les individus résistent au pouvoir, quelles que soient les formes que prend celui-ci. Il faut alors affirmer, selon une leçon que Jean-François Billeter reprend à Louis Dumont, que l’Occident ne s’oppose pas aux autres sociétés par l’invention de l’individu, mais que les différentes sociétés peuvent être comparées en ce qu’elles composent toutes, à des degrés divers, la hiérarchie et l’individu.
Le livre de Billeter se conclut donc par un vibrant appel à la responsabilité des individus, européens et chinois, contre les nouveaux pouvoirs qui se mettent en place, justifiés par des intellectuels en termes culturalistes.
Les Européens et les Chinois ont peut-être vécu dans des mondes séparés dans le passé, mais les séparations anciennes sont caduques. Ils partagent ensemble un même moment de l’histoire, doivent agir ensemble et donc s’entendre. Pour cela il faut qu’ils dominent le passé au lieu de se laisser dominer par lui. Que l’on cesse, de part et d’autre, de jouer les prolongations respectueuses et les réanimations artificielles. Constituons-nous ensemble en sujets de l’histoire et proclamons bien haut notre droit d’inventaire. Quand je dis « nous », je ne parle pas, bien entendu, des Européens pris collectivement, ni des Chinois pris collectivement, mais d’individus libres et responsables, c’est-à-dire de ce que nous appelons des « personnes ». (…) Pour moi, il n’y a rien au-dessus de la « personne », et surtout rien au-dessus de deux personnes qui s’entendent par l’usage de la parole et de la raison. C’est pourquoi je me sens en accord avec Tchouang-Tseu, qui a une position voisine et que je tiens en raison de cela pour le philosophe chinois le plus précieux et le plus actuel de tous.
Contre François Jullien, p. 82-83
Une telle déclaration finale présentait des signes de faiblesse, et François Jullien ne s’est pas privé de les relever. Affirmer que la « personne » est une réalité universelle et qu’il n’y a rien au-dessus que des constructions idéologiques fictives, c’est s’exposer à l’accusation de projeter sur les autres sociétés une conception particulière du monde, celle des intellectuels protestants de la République de Genève (il y a bien quelque chose de rousseauiste dans l’affirmation de Billeter selon laquelle il « se sent en accord » avec Tchouang-Tseu par-delà la barrière des langues). On échangerait alors un ethnocentrisme, celle de l’intellectuel parisien fasciné par l’altérité du pouvoir, pour une autre, celle de l’intellectuel genevois clamant haut et forts les droits de la personne. Mais l’objection est plus profonde qu’un simple échange de mauvais procédés. Pour faire une « personne » en communication rationnelle avec d’autres personnes, il faut bien une société, donc un pouvoir qui se reproduit par une idéologie. On n’échapperait donc pas au pouvoir, mais il faudrait plutôt comprendre de l’intérieur ses faiblesses et ses tensions.
Si on les lit généreusement, et non dans le ton condescendant et souvent insultant qui est le sien, la réplique de François Jullien à Jean-François Billeter va dans ce sens. Résumons brièvement les réponses de François Jullien dans un ouvrage, Chemin faisant, pour lequel Barbara Cassin et Alain Badiou ont créé une nouvelle série de la collection « L’ordre philosophique », intitulée « Réplique à *** », qui permet à Jullien de répondre à son contradicteur en ne le citant qu’une fois (les autres occurrences sont les initiales JFB), lui retirant l’honneur de faire figurer son nom dans sa bibliographie. Jullien répond à la première accusation, celle de reprendre un mythe français de l’altérité chinoise, en distinguant altérité et extériorité : la première est construite, la seconde est constatée (il reprend ici, sans le dire, la distinction opérée par Bachelard entre le fait scientifique constaté et le fait construit). Jullien met par ailleurs en valeur la pluralité de ses livres, qui ne peuvent être ramenés à la construction d’une pensée chinoise unifiée, en rappelant notamment son attention à la figure de Wang Fuzhi, philosophe chinois du XVIIe siècle (sur lequel Jacques Gernet a également travaillé dans ses cours au Collège de France à la fin des années 1970 : voir La raison des choses, Paris, Gallimard, 2005) qu’il compare à Pascal pour sa position à la fois intérieure et extérieure à la pensée lettrée traditionnelle (voir Procès ou création, p. 11) En réponse au second argument, celui de la traduction, Jullien signale plusieurs désaccords de traduction avec Billeter, notamment celui-ci, qui indique un désaccord de fond.
Puisque JFB me reprend sur la traduction de la célèbre formule taoïste : wu wei er wu bu wei, revenons sur elle. JFB traduit : « qui ne force rien peut tout ! » En chinois (mot à mot) : « ne pas agir mais/d’où ne pas agir ». En traduisant ainsi, JFB perd complètement le fait que la seconde partie de la formule se borne à reprendre la première sur un mode négatif : en ne respectant pas ce renversement interne, il délaisse sa valeur d’apparent paradoxe qui devait être également sensible aux contemporains du Laozi et sur laquelle celui-ci a lui-même insisté (…) ; ce type de formule se lit d’ailleurs en série, de concert avec d’autres : « savourer la non-saveur », « parler sans parler » (…) D’autre part, il laisse entièrement tomber le « mot vide », er, autour duquel la formule néanmoins pivote et qui la fait basculer. Il suffit d’ouvrir le petit Ricci pour constater que, comme outil de liaison, ce terme indique la conséquence (« par suite », « alors ») et l’opposition (« mais », « cependant » (…)). Comment ne pas voir alors que la richesse de cette formule vient précisément de ce qu’elle maintient ces deux sens adverses et dit à la fois : dans ces conditions, celle de la sagesse, « même si vous ne faites rien, rien ne sera pas fait » ; et en même temps : « parce que vous ne faites rien » (…) « tout se fait tout seul ».
Chemin faisant, p. 77-78
La méthode de traduction est ici valide : le sens de l’énoncé ne se donne pas à plein (en se remplissant d’un contexte) mais en rapport à d’autres énoncés aussi énigmatiques dans le même texte ou la même tradition textuelle, en déplaçant la signification d’un « mot vide ». Billeter répondra (dans « François Jullien, sur le fond ») que Jullien adopte sans le dire une conception taoïste du langage selon laquelle le langage peut s’amenuiser jusqu’à faire apparaître le fond énigmatique des choses, ce à quoi il oppose que le langage ne peut se constituer comme une réalité autonome qu’à partir d’un acte initial arbitraire, ouvrant un espace de constitution rationnelle pour l’individu ; mais à cette conception saussurienne du langage on peut faire l’objection de Jakobson selon laquelle les rapports entre les signes sont motivés en tant qu’ils déplacent la tension primitive entre le sens et l’absence de sens.
Cette discussion linguistique répond alors par elle-même au troisième argument, sur l’impossibilité d’une résistance au pouvoir dans la « pensée chinoise » décrite par Jullien : il ne s’agit pas d’opposer une force à une autre (celle de l’individu criant au pouvoir qui l’assujettit : « qui ne force rien peut tout ! ») mais de comprendre en quoi la pratique est intrinsèquement paradoxale (ne rien faire c’est en même temps tout faire), ce qui la conduit à la fois à reproduire le pouvoir et à le subvertir (selon une opposition qui passe souvent, dans les présentations que l’on fait de la philosophie chinoise, entre les interprétations confucianistes et taoïstes de la tradition lettrée). La pensée lettrée serait alors une idéologie, non au sens où elle constituerait un système hiérarchisé d’idées qui s’impose à l’individu (selon la définition de Louis Dumont que reprend Jean-François Billeter) mais au sens où elle reproduit dans son expression propre (qui est essentiellement linguistique) des contradictions existant dans les pratiques sociales (selon la définition de Marx que reprend Jullien : cf. Chemin faisant, p. 116). Il est alors illusoire d’opposer à l’individu existant universellement comme personne un système impérial qui se reproduit de façon homogène : en Chine même, les rapports entre le pouvoir et les individus ont varié selon que la conjoncture a renforcé ou affaibli les contradictions sociales, la période Ming étudiée par Billeter à travers la figure de Li Zhi apparaissant de ce point de vue comme une période de crispation du pouvoir impérial du fait de forces économiques nouvelles (provoquées notamment par les premiers contacts commerciaux avec l’Occident).
Peut-on alors décrire ces pratiques sociales par lesquelles se transforment les rapports entre le pouvoir et les individus en Chine ? La question, à vrai dire, oblige à sortir de la sinologie telle que la pratiquent à la fois François Jullien et Jean-François Billeter, c’est-à-dire à partir de textes. Si l’opposition entre les deux sinologues relève bien d’un désaccord réel, engageant toute une série de problèmes aux enjeux essentiels, reste qu’ils partagent un accord de fond selon lequel on a un accès privilégié à la Chine par ses textes, l’homogénéité de la tradition chinoise des origines jusqu’à nos jours étant présupposée par les deux sinologues en l’interprétant différemment – altérité pour l’un, impérialisme pour l’autre – du fait que la réalité des intellectuels chinois leur était jusqu’à récemment encore inaccessible.
Dans un texte récent intitulé « François Jullien, sur le fond », Jean-François Billeter revient sur l’émotion suscitée par son petit pamphlet en montrant que la méthode de François Jullien s’apparente par bien des aspects à celle de Martin Heidegger et soulève les mêmes difficultés (et de fait, le titre de la réplique de Jullien, Chemin faisant, semble une allusion à l’ouvrage de Heidegger : Chemins qui ne mènent nulle part) : même radicalité dans la recherche d’une alternative à la pensée rationaliste occidentale permettant de dégager son « impensé », même mise en valeur de l’absence du verbe « être » dans les autres traditions que l’Occident, même façon intemporelle de faire résonner les textes, même fascination contagieuse pour la poésie et son efficacité mystérieuse, même difficulté à assumer les questions politiques. Contre ce modèle heideggérien, Billeter défend celui de Hannah Arendt, remettant en valeur les conditions de l’action et de la liberté politique. Mais de Heidegger à Arendt, on reste dans une tradition herméneutique considérant les textes comme des entités closes que l’on ne peut comprendre qu’en les rapportant aux questions qui les motivent : question de la liberté individuelle pour Arendt, de l’existence sans Dieu pour Heidegger. On ne considère à aucun moment les textes comme des pratiques reflétant par leurs moyens propres ce qui se produit dans d’autres pratiques non-textuelles, en particulier du fait qu’elles sont porteuses, comme toutes les pratiques, de contradictions, en les portant à un niveau supérieur de réflexivité.
Il y a là une toute autre conception de l’histoire de la philosophie chinoise, comprise non comme un ensemble de textes portés par des auteurs, mais comme un ensemble de pratiques en rapport à des contextes sociaux. De cette histoire, on peut trouver une illustration dans les travaux de Joël Thoraval qui, au fil de plusieurs articles essentiels parus notamment dans Esprit, poursuit une observation sur le terrain des reconfigurations de la philosophie chinoise au gré de l’ouverture du régime communiste et de la réinvention d’une tradition nationaliste, se demandant en particulier ce qu’implique le fait pour un lettré chinois de se présenter comme « philosophe » dans un espace globalisé où la philosophie est principalement conçue comme « occidentale » (voir notamment « De la philosophie en Chine à "la Chine" dans la philosophie. Existe-t-il une philosophie chinoise ? », Esprit, mai 1994, p. 5-38). Il y a là place non plus pour une sinologie de la tradition lettrée ni même seulement pour une histoire de la philosophie, mais bien pour une anthropologie des philosophes ou des « lettrés », de leur fonction, de leurs conflits, de leurs reconfigurations… Il faudrait inclure dans cette étude tous ceux qui peuvent se réclamer de cette « pensée lettrée » dans leurs actions : syndicalistes, scientifiques, journalistes, administrateurs… Un véritable champ d’enquête s’ouvre avec l’explosion du capitalisme dans la Chine communiste : celle d’une anthropologie des pratiques intellectuelles dans un espace géographiquement très différent du nôtre (On peut considérer les interventions de Jean-Marie Schaeffer et Bruno Latour dans les deux ouvrages collectifs discutant le travail de François Jullien comme des appels à ce genre d’anthropologie).
Que garde une telle anthropologie de la notion d’« altérité » chinoise ? On peut conserver l’idée de François Jullien selon laquelle la Chine constitue un détour pour poser les problèmes critiques qui concernent notre activité de pensée, sans adhérer à sa thèse selon laquelle la différence entre la Chine et l’Occident serait une différence de conception du monde (selon l’opposition de l’immanence et de la transcendance). Jean-François Billeter a bien posé le problème en soulignant que la Chine nous permettait de penser sociologiquement le phénomène du mandarinat que notre tradition de pensée a tendu à refouler, mais il a trouvé dans l’opposition entre le pouvoir et la personne (exprimée par quelques individus exceptionnels comme Li Zhi ou Zhuangzi) la forme universelle permettant d’effectuer cette étude.
Contre cette thèse, il faut affirmer que la sociologie n’est pas seulement une sociologie du pouvoir et de ses résistances mais d’abord une sociologie des organisations sociales, de leurs contradictions et de leurs expressions idéologiques. Il n’y a rien là d’original : c’est la sociologie durkheimienne revue et corrigée par le marxisme. De cette démarche, on peut trouver une illustration dans la grande tradition que Jullien autant que Billeter tendent à laisser de côté, la citant seulement par déférence envers les grands ancêtres : celle de Marcel Granet, élève de Durkheim, ami de Mauss, dont l’ouvrage sur les « catégories matrimoniales en Chine ancienne » est à l’origine de la thèse de Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté. Dans son ouvrage constamment réédité intitulé La pensée chinoise, Granet reprend en effet à Durkheim la thèse selon laquelle les formes de pensée doivent être rapportées aux organisations sociales dont elles sont une représentation ou un emblème. Cette thèse s’applique particulièrement bien à la pensée chinoise, puisque l’écriture calligraphique adoptée il y a plusieurs millénaires en Chine a pour fonction de représenter les choses dans un ordre qui reflète l’harmonie du social.
Cette démarche a ensuite été reprise par le grand sinologue Léon Vandermeersch dans sa thèse, Wangdao ou la Voie Royale. Recherches sur l’esprit des institutions de la Chine archaïque, parue en 1980. Vandermeersch montre à la suite de Granet que l’organisation sociale chinoise se caractérise par un grand formalisme (visible notamment dans l’attention aux règles de filiation) que l’on peut retrouver dans les formes de pensée à travers le souci pour la conservation de l’ordre social et cosmologique manifesté par le rituel. Il est le premier en France à montrer, à la suite des travaux de l’école japonaise, que l’écriture chinoise est issue des pratiques de divination à partir des craquelures sur les écailles de tortue. Dans une filiation très durkheimienne, Vandermeersch montre alors que « l’esprit des institutions » chinoises est issu du sacrifice des animaux à des fins de divination, progressivement raffiné par la pratique de l’écriture et le formalisme du rituel, jusqu’à être intériorisé dans le sentiment de piété filiale et d’humanité valorisé par le confucianisme. Vandermeersch réintroduit ainsi dans l’organisation sociale tout ce qui pouvait sembler exclu par une approche trop abstraite du « pouvoir », en particulier les relations aux animaux et aux ancêtres.
On peut cependant préférer à sa vision par trop évolutionniste du raffinement croissant de la pensée chinoise, allant du sacrifice animal à la piété filiale, la description que fait Jean Lévi de la figure de Confucius, et que reprend à son compte Jean-François Billeter dans ses Études sur Tchouang-Tseu (p. 163-193). Selon le récit qu’en fait Jean Lévi (par ailleurs auteur d’un magnifique roman, Le rêve de Confucius), Confucius n’était pas un sage intériorisant progressivement l’ordre du monde, mais un individu violent et ironique, pris à partie dans une période de turbulence politique, et qui s’imposa comme maître à penser parce qu’il donna le premier une solution au problème du sacrifice, qui grevait lourdement l’économie des premiers royaumes chinois : cesser de donner des offrandes en sacrifices aux morts et aux dieux, et pourtant continuer à s’adresser à eux comme s’ils étaient vivants (Confucius, Pygmalion, 2002, p. 47). Confucius invente ainsi le sérieux de la croyance par laquelle on se rapporte aux ancêtres en les faisant vivre non plus réellement (ils n’ont plus besoin de nourriture) mais en pensée (leur nourriture étant purement intellectuelle). Ainsi s’explique que Confucius ait fait du respect des textes classiques le fondement de la religion chinoise.
À lire un tel récit, on se prend à penser qu’une anthropologie de la pensée en Chine ne doit pas partir du sacrifice qu’elle aurait progressivement intériorisé (ce qui reprendrait le schéma du pouvoir auquel doit consentir l’individu pour devenir personne ou sujet) mais des contradictions du sacrifice que la pensée a déplacées à travers des organisations sociales et des formes de pensée de plus en plus compliquées. Il y a bien un espace social différent en Chine et en Europe (l’Europe a davantage développé l’espace public au cœur de la cité, comme l’ont montré les travaux de Vernant et Habermas, la Chine a davantage développé le système des examens, comme l’a bien montré Billeter), en sorte qu’il est bon de passer de l’Europe vers la Chine et en retour pour décrire ce que chaque forme sociale a refoulée (en lui laissant de moindres chances de se développer) ; mais ce qui permet cette comparaison est le caractère universel des contradictions du sacrifice. Il y a donc bien intérêt à faire le détour par la Chine, non pour dégager l’impensé de notre pensée, mais pour enquêter sur les conditions sociales et anthropologiques de notre pensée.
Ouvrages de François Jullien
Lu Xun, Écriture et révolution, Paris, Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 1979
La valeur allusive. Des catégories originales de l’interprétation poétique dans la tradition chinoise, Paris, École Française d’Extrême Orient, 1985 (rééd. PUF ?)
Procès ou création. Une introduction à la pensée des lettrés chinois, Paris, Seuil, « Des travaux », 1989
« Lecture ou projection : Comment lire (autrement) Wang Fuzhi ? », Études chinoises, vol. IX, n° 2, automne 1990
Éloge de la fadeur, Paris, Philippe Picquier, 1991
La propension des choses, Pour une histoire de l’efficacité en Chine, Paris, Seuil, « Des travaux », 1992
Figures de l’immanence. Pour une lecture philosophique du Yiking, Paris, Grasset, 1993 (rééd. Livre de poche 1995)
Le détour et l’accès. Stratégies du sens en Chine et en Grèce, Paris, Grasset, 1995 (rééd. Livre de Poche 1997)
Fonder la morale. Dialogue de Mencius avec un philosophe des Lumières, Paris, Grasset, 1995 (rééd. Livre de Poche 1998)
Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, 1996
Un sage est sans idée, ou l’autre de la philosophie, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 1998
De l’essence du nu, Paris, Seuil, 2000 (rééd. « Points-essais » 2005)
Penser d’un dehors (la Chine). Entretiens d’Extrême-Occident (avec T. Marchaisse), Paris, Seuil, 2000
Du « temps ». Éléments d’une philosophie du vivre, Paris, Grasset, 2001
La grande image n’a pas de forme. Ou du non-objet dans la peinture, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2003
L’ombre au tableau. Du mal ou du négatif, Paris, Seuil, 2004 (rééd. « Points-essais » 2006)
Nourrir sa vie. À l’écart du bonheur, Paris, Seuil, 2005
Si parler va sans dire. Du logos et d’autres ressources, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2006
Chemin faisant, connaître la Chine, relancer la philosophie, Réplique à***, Paris, Seuil, 2007
Ouvrages de Jean-François Billeter
Li Zhi, philosophe maudit (1527-1602). Contribution à une sociologie du mandarinat de la fin des Ming, Paris/Genève, Droz, 1979
L'art chinois de l'écriture, Genève, Skira,1989
« Comment lire Wang Fuzhi ? », Études chinoises, vol. IX, n° 2, automne 1990
Mémoire sur les études chinoises à Genève et ailleurs, Genève, Librairie du Rameau d'Or, 1998
Leçons sur Tchouang-Tseu, Paris, Allia, 2003
Études sur Tchouang-Tseu, Paris, Allia, 2004
Chine trois fois muette, Essai sur l’histoire contemporaine et la Chine, suivi de Essai sur l’histoire chinoise, d’après Spinoza, Paris, Allia, 2006
Contre François Jullien, Paris, Allia, 2006
« Réponse à Patrice Fava, À propos de Contre François Jullien », Études chinoises, XXXV, 2006, p. 187-197.
« François Jullien, sur le fond », Monde chinois, Automne 2007, n° 11, p. 67-74
Ouvrages sur François Jullien
T. Marchaisse et L.H. Khoa (dir.), Dépayser la pensée. Dialogues hétérotopiques avec François Jullien sur son usage philosophique de la Chine, Paris, Seuil, « Les Empêcheurs de penser en rond », 2003
P. Chartier et T. Marchaisse (dir.), Chine/Europe. Percussions dans la pensée à partir du travail de François Jullien, Paris, PUF, 2005
A. Chieng, La pratique de la Chine, en compagnie de François Jullien, Paris, Grasset
Oser construire. Pour François Jullien, Paris, Seuil, « Les Empêcheurs de penser en rond », 2007 (textes d’A. Badiou, B. Latour, J.-M. Schaeffer, P. Ricoeur)
Ouvrages sur la philosophie chinoise
Feng Youlan, A Short History of Chinese Philosophy (edited by Derk Bodde), Toronto, Mac Millan, 1948
J. Thoraval, « De la philosophie en Chine à « la Chine » dans la philosophie. Existe-t-il une philosophie chinoise ?, Esprit, mai 1994, p. 5-38
A. Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, « Points-essais », 1997
J. Lévi, Confucius, Paris, Pygmalion, 2002
Mou Zongsan, Spécificités de la philosophie chinoise, introduction de J. Thoraval, Paris, Cerf, 2003
Jacques Gernet, La raison des choses. Essai sur la philosophie de Wang Fuzhi (1619-1692), Paris, Gallimard, 2005
A. Cheng (dir.), La pensée en Chine aujourd’hui, Paris, Gallimard, « Folio-essais», 2007
Classiques de la sinologie en langue française
Lettres édifiantes et curieuses de Chine par des missionnaires jésuites 1702-1776, présentées par Isabelle et Jean-Louis Vissière, Paris, Garnier-Flammarion, 1979
Lettres édifiantes et curieuses sur la langue chinoise, Humboldt/Abel-Rémusat (1821-1831), éditées par Jean Rousseau et Denis Thouard, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1999
Pierre Laffite, Considérations sur l’ensemble de la civilisation chinoise et sur les relations de l’Occident avec la Chine, Paris, Dunod, 1861.
Marcel Granet, La pensée chinoise, Paris, La Renaissance du livre, 1934 (rééd. 1968 et 1988, avec une préface de Vadime Elisseeff)
Victor Segalen, Essai sur l’exotisme, Paris, Fata Morgana, 1978 (rééd. Livre de poche 1986)
Léon Vandermeersch, Wangdao ou la Voie Royale. Recherches sur l’esprit des institutions de la Chine archaïque, Paris, École Française d’Extrême Orient, 1980
Jacques Gernet, Chine et christianisme, la première confrontation, Paris, Gallimard, 1982
Simon Leys, Essais sur la Chine, Paris, Robert Laffont, 1998
Michel Cartier, La Chine entre amour et haine, Actes du VIIIe colloque de sinologie de Chantilly, Desclée de Brouwer, 1998