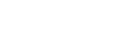Humboldt rencontre la Chine sous la forme d’une objection. La Chine semble contredire la thèse générale de Humboldt sur la nature du langage. En un mot : la langue chinoise contredit la proposition selon laquelle « seules les langues grammaticalement formées possèdent une aptitude parfaite au développement des idées ».
« Über das Enstehen der grammatischen Formen, und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung » (en abrégé Entstehen), GS IV, 310. Les œuvres de Humboldt seront citées d’après l’édition des Gesammelte Schriften de l’Académie de Berlin [en abrégé GS, suivi du numéro de volume et de la pagination], Berlin, 1903-1936; reprise chez Walter de Gruyter, 1968. Le mémoire est à la fois un exposé général de la théorie du langage et le point de départ de la discussion sur la Chine. Il se trouve dans les GS IV, 285-313, il est également édité par J. Trabant, dans le recueil Über die Sprache : Reden vor der Akademie, Tübingen & Basel, Francke, 1994 pp. 52-81. Il a été traduit par Alfred Tonnelé en 1859, sous le titre De l’Origine des formes grammaticales. Cette traduction a été reprise en 1969, aux éditions Ducros (avec la lettre à Abel-Rémusat). Une nouvelle traduction, due à Denis Thouard et Jean Rousseau, est parue en 1999, sous le titre « Sur la naissance des formes grammaticales et leur influence sur le développement des idées », aux Presses Universitaires du Septentrion (Lille), dans un dossier intitulé Lettres édifiantes et curieuses sur la langue chinoise (en abrégé Lettres). Notre travail est redevable de toutes les indications fournies dans ce dossier très complet sur la question chinoise chez Humboldt.
En effet le chinois ne contient pas d’authentiques formes grammaticales et pourtant a rendu possible une littérature qui, par sa richesse, son antiquité, son degré de développement intellectuel, se révèle parfaitement adaptée à la pensée la plus déliée. La proposition en question n’est pas marginale dans la philosophie du langage de Humboldt, elle en constitue une conséquence synthétique. Par conséquent l’objection vise la philosophie du langage dans son principe. Je rappellerai brièvement ce principe pour faire apparaître la portée de l’objection. J’examinerai ensuite la manière dont Humboldt traite cette objection, en se confrontant à la sinologie représentée par Abel-Rémusat. Je tirerai enfin des conséquences plus larges de cette rencontre pour le statut de la métaphysique dans son rapport à une altérité qu’elle ne comprend pas.
Réduire la question chinoise chez Humboldt à l’objection qui vient d’être mentionnée est bien entendu une simplification qui ne rend pas compte de la complexité historique de la formation de la réflexion de Humboldt sur cette question. Mais cette histoire, dont on trouvera les annales dans les Lettres, n’est pas l’objet du présent travail. Nous cherchons plutôt, à travers cette épure de la position de Humboldt, à définir un événement de la raison. Humboldt en effet est le représentant de l’héritage allemand des Grecs, tel qu’il s’est actualisé avec Schiller à Iéna. Pour lui la raison s’accomplit en logos, dans le discours qui en sa sonorité plastique recueille les rapports infinis du sens et de la pensée. Toute la question est de savoir si la Chine peut être simplement comprise par le logos. Et si elle ne l’est pas, non comment sera-t-elle définie par la raison sinon comme l’irrationnel, c’est-à-dire comme ce que la raison elle-même pose, à partir des rapports qu’elle comprend, comme ce qui les excède ?
Rappelons succinctement (et schématiquement) les étapes historiques de cette formulation de la question chinoise. 1°) Le point de départ est le mémoire de 1822, dans lequel Humboldt relève, en passant, « une objection importante contre l’affirmation de la nécessité de ces formes [grammaticales] » (GS IV, 311 ; Lettres, p. 100); 2°) cette objection est relevée et discutée par le sinologue Abel-Rémusat dans le compte-rendu qu’il donne en 1824, dans le Journal Asiatique, du mémoire de Humboldt ; celui-ci se trouve par là incité à approfondir sa connaissance du chinois, ce qu’il fait en prenant connaissance des Elemens de grammaire chinoise (1822) du même Abel-Rémusat. 3°) Humboldt traite directement de la question du « génie de la langue chinoise » dans sa lettre ouverte à Abel-Rémusat datée du 7 mars 1826. La correspondance entre Humboldt et Abel-Rémusat, amorcée dès 1824, se prolonge jusqu’en 1831. La question chinoise est également abordée dans la Verschiedenheit.
Dans le mémoire lu à l’Académie des sciences de Berlin le 17 janvier 1822, et portant « sur la naissance des formes grammaticales et leur influence sur le développement des idées », Humboldt, précise la relation générale entre le langage et la pensée – qui est son principe fondamental – en posant une corrélation entre une forme grammaticale, c’est-à-dire l’expression dans un signe explicite d’une relation, et la détermination de la pensée. Plus la grammaire, toujours implicite dans une langue, s’expose dans des signes spécifiques, notamment dans le système de flexion, plus le concept s’individualise, parce que l’individu ne se développe et ne s’affirme qu’en diversifiant son réseau de relations avec d’autres individus. La pensée n’est pas une chose, elle est une activité, ou, pour reprendre le terme aristotélicien qu’utilise souvent Humboldt dans sa version fichtéenne, elle est une energeia.
« La langue elle-même n’est pas une œuvre achevée [Werk] (Ergon), mais une activité [Thätigkeit] (Energeia). Aussi sa vraie définition ne peut être que génétique. » (Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihre Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts [rédigé entre 1830-1835], GS VII, 46) Nous traduisons les passages tirés de cet ouvrage [en abrégé Verschiedenheit]. Une remarque chronologique s’impose ici. Le grand texte théorique de 1830-1835 est le résultat et la synthèse de l’ensemble des réflexions de Humboldt sur le langage. Entre la rédaction de Entstehen et celle de la Verschiedenheit, la pensée de Humboldt a évolué, notamment, comme on le verra, sur la question du chinois. Il peut sembler imprudent de faire appel indifféremment aux deux textes. Nous ne nous citerons donc la Verschiedenheit que pour rappeler des propositions fondamentales et invariantes de la pensée théorique de Humboldt.
Elle se déploie donc dans un mouvement, dans un devenir, qui est auto-détermination, donc à la fois affirmation de soi, et explicitation, définition, précision de soi. On ne peut donc se contenter d’étudier une langue comme un système statique de structures lexicales ou syntactiques, il faut l’inscrire dans son energeia, dans la dynamique de l’objectivation de la pensée dans un sujet.
D’où la méthode génétique mise en œuvre par Humboldt, qui consiste à envisager les formes grammaticales non pas dans leur état figé (synchronie pure), ni non plus dans une simple description des différentes étapes de l’évolution d’un langue, ou des différentes langues (diachronie pure), mais dans un processus, Entstehen [terme que ne rend pas la traduction par origine ou par naissance ; il serait préférable de comprendre : genèse], un développement qui est une intensification conjointe de la faculté de parler et de la faculté de penser. Précisément parce qu’on ne pense qu’avec le mot, dans le mot, la pensée n’existe pas comme une donnée immédiate de la conscience, elle prend naissance dans l’apprentissage même du langage, par conséquent elle n’est pas une nature immuable, mais un progrès qui peut aussi bien être compris de manière ontogénétique comme culture de soi de l’individu, que de manière phylogénétique, comme formation du genre humain. L’homme n’existe, en tant qu’être pensant, que dans une genèse. Son être est un devenir ; non pas parce qu’il subirait une causalité naturelle extérieure, qui le soumettrait à des fluctuations indépendantes de sa volonté, mais parce que sa volonté elle-même, son acte, est une progression. La « faculté de langage » qui spécifie l’homme, ne peut être comprise que dans « un développement progressif ». La langue ne cesse d’être exprimée dans la fluidité de la parole singulière, qui progresse elle-même dans l’apprentissage et le perfectionnement de l’usage de la langue. Cette double interaction conduit à penser la réalité linguistique comme essentiellement fluante. « La langue, saisie dans son essence effective, est continûment et à chaque instant dans un processus qui va de l’avant [etwas… Vorübergehendes] » (Ibid., GS VII, 45) Mais cette plasticité vient de l’effort constant de la formation de soi qui accompagne la transformation de la matière sonore aux intensions de signifier.
Ainsi la diversité des langues, que pourrait sembler contredire l’unité du genre humain, en tant qu’il se définit précisément par la faculté de langage – car parler une autre langue, est s’ouvrir à une autre vision du monde – devient le champ où s’effectue la formation, la culture (Bildung), qui est l’existence même de l’homme. Les langues diverses, et par là différentes donc relativement incommunicables, ne sont que les degrés (Stufen) d’un même développement progressif.
Humboldt retourne de manière particulièrement élégante, leibnizienne, l’argument sceptique traditionnel fondé sur la diversité : Si les hommes sont ce que le langage a fait d’eux, alors les hommes qui parlent des langues différentes non seulement ne se comprennent pas, mais n’ont pas de monde commun ; aucune rationalité ne peut donc les unir. Pour Humboldt au contraire, cette diversité est le gage de l’unité du genre humain. Car l’individuation parfaite de chaque langue, qui s’effectue dans un caractère national déterminé, est la condition de l’accomplissement général de tous les degrés de progression du genre humain dans sa continuité et son universalité. « L’individualité est l’unité de la diversité » (« Über den Nationalcharaketer der Sprachen », GS IV, 420, traduction Denis Thouard, « Sur le caractère national des langues » dans un recueil qui porte le même titre, Paris, Seuil, 2000, p. 131). On peut comprendre cette formule leibnizienne de deux façons : dans un premier sens, pour chaque langue considérée, l’individualité est la manière dont se définit un caractère qui unifie l’ensemble des traits linguistiques épars en leur donnant une forme, une « âme ». Certaines langues ont une unité par agrégation, comme l’unité d’un tas de sable. D’autres ont une véritable unité parce que tous éléments sont rattachés à un même principe actif, ou un même caractère. Plus la langue est individuée, plus elle se distingue des autres langues, et s’affirme, et la nation avec elle, dans son originalité. Cela ne peut être que le résultat d’un processus de formation de soi. « L’individualité vraiment spirituelle ne peut se trouver que dans les langues qui ont déjà atteint un degré supérieur de formation de soi [Ausbildung]. » (Ibid. IV, 421) L’individualité ne peut donc elle-même être comprise que de manière dynamique.
C’est ici qu’intervient le second sens de la formule. D’une part l’individuation ne se fait jour qu’à un certain stade du processus interne de formation de la langue, et ne peut donc être saisie que pour des langues déjà accomplies, selon une méthode génétique ; d’autre part, l’individuation est la condition pour comprendre la diversité dans une unité nouvelle, qui n’est plus celle du caractère national, mais celle du genre humain lui-même. Plus les langues s’individualisent, plus elles se distinguent, mais, en même temps, plus elles actualisent dans leur diversité même l’unité véritable de la faculté de langage, donc de l’homme. « C’est précisément de cette diversité que dépend absolument la réussite de la tendance à l’universel. » (Verschiedenheit, GS VII, 38) L’homme joue, mutatis mutandis, le même rôle que Dieu dans le chœur des monades leibniziennes. Il a une véritable unité non pas en tant qu’il rassemble dans une totalité indéfinie des multiplicités indifférenciées, mais en tant qu’il est un par la diversité réelle de ses parties, dont chacune forme une unité spirituelle, animée par son energeia propre. Les hommes individuels trouvent d’abord une unité à travers la médiation de l’individualité nationale, et l’ensemble des individualités différenciées trouvent ensuite leur unité dans « l’essence totale de l’homme » dont elles développent un point de vue à partir d’une vision du monde spécifique. « L’aspiration vers la totalité et l’effort pour y parvenir sont immédiatement donnés avec le sentiment de l’individualité et ils se renforcent au même degré que celui-ci s’aiguise, puisque tout individu singulier porte en lui l’essence totale de l’homme, mais sur une voie de développement singulière. » (Ibid., GS VII, 37) Chaque usage singulier de la langue, chaque acte linguistique particulier constitué par l’interaction de l’intention de signifier d’un sujet et la compréhension par un autre sujet, est à la fois l’accomplissement de la subjectivité singulière, du caractère particulier de la langue, et de l’universalité de l’homme ; un tel acte ne serait pas possible « si l’unité de la nature humaine ne se trouvait dans la diversité des individus singuliers, seulement fragmentée entre les individualités isolées. » (Ibid., GS VII, 57)
La méthode génétique, si elle considère chaque langue, chaque culture, chaque vision du monde, dans son devenir, ne s’appuie pas pour autant sur une représentation héraclitéenne d’un mobilisme généralisé, qui livrerait l’idée d’homme à la multiplicité indéfinie des faits humains, et à la relativité des points de vue ouverts par chaque individualité culturelle. Tout processus a un point de culmination interne d’une part ; il s’inscrit d’autre part dans une totalité dont l’accomplissement, même s’il est réalisé à travers les médiations singulières, est le fondement ultime de ces dernières ; de même que l’individuation de chaque substance individuelle, bien qu’elle trouve son unité interne dans son âme propre, a son fondement ultime dans l’unité divine.
Chaque langue parcourt différents degrés jusqu’à son point d’accomplissement, mais elle constitue en elle-même un degré dans une échelle plus générale des langues dont la totalité constitue le tableau complet des energeiai qui forment l’humanité totale. L’orientation de ce tableau, de l’inférieur vers le supérieur, du moins parfait vers le plus parfait, ne constitue pas une appréciation esthétique ou arbitraire des mérites des langues, mais est une conséquence de la méthode génétique. De même qu’un vestige de squelette animal ne se comprend qu’à partir de la totalité achevée non seulement du squelette lui-même, mais de la totalité de l’être vivant dans l’accomplissement de l’ensemble de ses fonctions, et que ce lien organique permet de reconstituer cette totalité à partir d’un fragment, de même toute langue constitue un degré dans le développement progressif de la faculté de parler, qui peut être anticipée à partir de l’usage du particulier. Si Humboldt rappelle souvent son souci, dans la comparaison des langues, de s’en tenir aux faits, c’est-à-dire à la connaissance positive des langues, et s’il se défie des théories générales sur le langage, ce n’est pas par un choix empiriste hostile à l’abstraction d’un universalisme rationaliste. Il ne s’en tient pas au particulier comme tel, mais il recueille dans celui-ci, comme un naturaliste, un élément qui vient prendre sa place dans un tableau général défini par la ligne directrice d’une orientation du plus indéterminé vers le plus déterminé, du l’inchoatif vers le développé. De même qu’on ne peut penser l’unité totale du cercle qu’à travers la diversité des rayons qui convergent en elle, de même, et inversement, on ne peut comprendre chaque rayon qu’en le replaçant dans le cercle qu’il forme. Cette méthode est conforme aux règles énoncées dans l’Appendice à la Dialectique transcendantale de la Critique de la Raison pure : les idées de la raison fournissent une unité systématique qui donne sens à l’ensemble des données ponctuelles recueillies dans l’expérience par la connaissance d’entendement. « Même comprendre l’essence spécifique d’une nation et la cohérence interne d’une langue singulière, de même que la relation de celle-ci avec les exigences linguistiques générales, dépend absolument entièrement de la considération de la caractéristique spirituelle de la totalité » (Ibid., GS VII, 14).
Non seulement l’étude de chaque langue enrichit la saisie d’ensemble de l’humanité, mais elle n’est possible qu’à partir de l’idée de totalité, ou d’unité systématique. Par conséquent une langue dont la spécificité individuelle ne pourrait pas trouver place dans cette unité systématique réglée par l’idée d’humanité, serait totalement incompréhensible : rebelle à toute investigation scientifique parce qu’elle n’appartiendrait pas à l’espace commun dans lequel l’ensemble des langues nationales inscrivent leur caractère. Une langue indéchiffrable par la science de l’homme parce qu’elle sort de la définition de l’humanité comme processus de formation culturelle. Une telle langue serait une contradictio in adjecto, puisqu’elle n’aurait de langue que le nom, sans appartenir à ce qui fait l’essence de la langue, à savoir l’humanité. « La langue est, même dans ses commencements, intégralement humaine » (Ibid., GS VII, 60). « La langue surgit d’une profondeur de l’humanité, qui interdit partout de la considérer comme une œuvre spécifique et une création des peuples. » (Ibid., GS VII, 17) Cette présence de l’humanité dans la langue n’est pas limitée aux formes linguistiques les plus accomplies. Ce n’est pas à la perfection que se reconnaît l’humanité, mais au fait de participer au processus de formation – peu importe à quel degré de l’échelle. Une langue qui n’appartiendrait pas à ce processus, à quelque niveau que ce soit, qui existerait donc indépendamment du devenir proprement humain des langues, serait non seulement une anomalie, mais constituerait une remise en question radicale des principes philosophiques de l’étude des langues.
Or tel est bien le statut que Humboldt assigne à la langue chinoise. La Chine est le nom que prend cette incommensurabilité qui vient troubler la rationalité anthropologique et linguistique. La raison de ce statut singulier tient, comme on l’a indiqué plus haut, au rôle que joue la grammaire dans la gradation des langues. Une langue est d’autant plus accomplie qu’elle parvient à individualiser la pensée, c’est-à-dire à marquer par des formes spécifiques les relations que les concepts entretiennent les uns avec les autres dans la continuité d’une pensée qui se tisse progressivement jusqu’à former une totalité à la fois unifié, cohérente et riche. La langue s’organise alors exactement comme la pensée individuelle, elle devient cette pensée en acte, aussi liée qu’elle est déliée. « La pensée, qui se produit au moyen de la langue, est dirigée soit vers des buts corporels, soit sur elle-même, et donc vers un but spirituel. Dans cette double direction, elle requiert la distinction et la détermination des concepts, qui dépendent dans la langue pour la plus grande part du mode de désignation des formes grammaticales. » (Entstehen, GS IV, 307, Lettres p. 96) La distinction et la détermination ne sont pas des caractères absolus des concepts, mais elles caractérisent le concept dans la relation avec les autres concepts, par la comparaison qui fait ressortir tout à la fois la liaison et la différence. Lorsque cette liaison n’est pas marquée par une forme spécifique, le concept est certes en soi, dans l’absolu, tout aussi vivace, mais il est dépourvu de portée et de sens puisqu’il lui manque l’organe qui lui permet de s’insérer dans le tissu conceptuel à partir duquel il prend, dans chaque contexte, son sens propre.
Cette forme qui tout à la fois se rattache organiquement au concept, et désigne en lui autre chose que lui, la part que prend sur lui la relation à l’autre, trouve son aboutissement dans le système de la flexion, qui joint immédiatement, dans l’unité du mot, à la racine immuable du sens l’indice de l’intention tournée vers autre chose. La flexion fait varier le mot, non pour le laisser se dissoudre dans une fluctuation indéterminée mais, au contraire, pour l’actualiser plus fermement, dans chaque situation singulière à laquelle la pensée applique son énergie, par la précision de la liaison avec la totalité du discours. La flexion est l’exposant le plus fécond de l’intention grammaticale puisqu’il n’oblige pas le concept à recourir à un expédient extérieur à lui, à un mot grammatical (préposition, conjonction) pour s’orienter dans le flux de la pensée. Le degré inférieur de la grammaire est au contraire celui où les intentions grammaticales – car il y toujours, dans toute langue, une grammaire implicite, qui vient de la relation de toute partie du discours à son sens général – ne sont absolument pas marquées, où elles sont pour ainsi dire élidées. Une langue qui se passe de tels marqueurs de transition peut certes parvenir au même degré de compréhension, mais elle le fera d’une manière analogue à la simple désignation gestuelle, dont le signe confronte directement à la chose, sans la médiation du sens. Dès lors, comme par le geste, c’est la place qui est désignée, et il importe que celle-ci soit toujours respectée dans la phrase pour que l’intention grammaticale puisse être suggérée par le locuteur, ou reconstituée par le récepteur du message. Seule la position des mots, non les mots eux-mêmes, tient lieu de grammaire. Une langue dont la grammaire est rudimentaire ne permet pas à la pensée de bénéficier de la « réaction importante et bienfaisante » qu’exerce sur elle « l’expression de la forme grammaticale en tant que telle » (Ibid., GS IV, 294, Lettres p. 87). Elle parvient sans doute par des expédients à « exprimer une grande abondance d’idées » (Ibid., GS IV, 294, Lettres p. 86), mais il n’existe pas d’appropriation naturelle entre le langage et la pensée, pas plus qu’il ne pourrait en exister avec une langue symbolique purement artificielle. A l’opposé, une langue à flexion, dont le grec fournit le type accomplit, porte à la perfection l’expression alerte et précise de la pensée. « L’acuité de la pensée y gagne quand les rapports grammaticaux aussi correspondent précisément aux rapports logiques et l’esprit est toujours plus fortement porté à la pensée formelle, quand la langue l’habitue à une distinction tranchée des formes grammaticales. » (Ibid.)
On notera que Hegel développe une argumentation comparable, non certes directement à propos des formes grammaticales inhérentes à la langue, mais à propos de l’étude de la grammaire qui « conditionne le commencement de la culture logique ». « La grammaire a, en effet, pour contenu, les catégories, les productions et déterminations propre à l’entendement ; c’est donc en elle que l’on commence à apprendre l’entendement lui-même. » (Textes pédagogiques, traduction B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1990, p. 85)
Une langue qui dispose d’une grammaire authentique se prête à un usage dans lequel elle cesse d’être un simple moyen de communication, et devient l’objet direct de l’effort de la pensée, qui ne tend plus seulement à s’extérioriser, mais à s’affiner en affinant la langue elle-même. La créativité qui est à l’œuvre dans la langue, le pouvoir créateur des nations, l’énergie, vivifie la pensée elle-même et donne au sujet une vivacité qui lui permet de porter la langue elle-même à un plus haut degré de détermination.
« Dans les langues, les nations sont, en tant que telles, authentiquement et immédiatement créatrices. » (Verschiedenheit, GS VII, 38) Dans la Lettre à M. Abel-Rémusat [en abrégé Lettre], on lit : « […] je suis pénétré de la conviction qu’il ne faut pas méconnaître cette force vraiment divine que recèlent les facultés humaines, ce génie créateur des nations, surtout dans l’état primitif où toutes les idées et même les facultés de l’âme empruntent une force plus vive de la nouveauté des impressions, où l’homme peut pressentir des combinaisons auxquelles il ne serait jamais arrivé par la marche lente et progressive de l’expérience. Ce génie créateur peut franchir des limites qui semblent prescrites au reste des mortels, et s’il est impossible de retracer sa marche, sa présence vivifiante n’en est pas moins manifeste. » (GS, V, 286-287 ; Lettres, p. 157)
La création nationale se prolonge en création individuelle, et l’œuvre de l’individu explicite la pensée immanente à la langue, et par là, transforme la langue elle-même en langue de culture. « Dans la réaction de la langue sur l’esprit, la forme grammaticale authentique, même lorsque l’attention n’est pas intentionnellement dirigée sur elle, fait l’impression d’une forme et produit une culture formelle. » (Enstehen, GS IV, 309, Lettres p. 99) Or le produit le plus remarquable de cette culture est, selon Humboldt l’art du discours, tel qu’il s’est développé dans la Grèce antique : « Car il est indéniable que c’est dans l’exposé dialectique et rhétorique que se montre avec le plus d’éclat la rapidité et l’acuité de la pensée favorisées par une riche multiplicité de formes grammaticales formées de manière déterminée et aisée, et c’est pour cela qu’elle déploie sa plus grande force et sa plus grande finesse dans la prose attique. » (Ibid., GS IV, 311, Lettres p. 101)
Nous disposons désormais des éléments pour comprendre en quoi la langue chinoise contredit les principes généraux de la philosophie du langage de Humboldt. Elle est en effet une langue qui, du point de vue grammatical, se situe au degré zéro de la forme, et qui, néanmoins a rendu possible une « littérature florissant depuis des millénaires » (Ibid. GS, IV, 311, Lettres p. 100), qui prouve le haut degré de sa culture intellectuelle.
Ces deux caractéristiques, antinomiques dans le système de Humboldt, doivent être explicitées.
Tout d’abord le chinois présente l’état le moins développé de la grammaire. Les mots chinois non seulement ne portent aucun exposant d’une intention grammaticale, mais ne sont même pas différenciés en eux-mêmes selon les catégories grammaticales. Le même mot peut être tour à tour verbe, substantif, adjectif, spécificatif, démonstratif, préposition ; « […] pour indiquer la liaison des mots dans ses phrases, [la langue chinoise] ne fait point usage des catégories grammaticales, et ne fonde point sa grammaire sur la classification des mots, mais fixe d’une autre manière les rapports des éléments du langage dans l’enchaînement de la pensée. »
Lettre, GS V, 256, Lettres, p. 126. C’est la thèse fondamentale de Humboldt sur le chinois, constamment reprise sous diverses formes. « Les Chinois […] s’énoncent souvent de manière à laisser indéterminée la catégorie grammaticale à laquelle il faut assigner un mot employé ; mais ils ne sont pas forcés d’ajouter à la pensée, là où elle n’en a que faire, l’idée précise que telle ou telle forme grammaticale entraîne d’après elle. » (Lettre, GS V, 263, Lettres, p. 134) « Dans un idiome où l’absence de ces exposans [s.e. des rapports grammaticaux] forme la règle, l’esprit ne saurait être porté à y suppléer, comme dans celui où cette absence est comptée parmi les exceptions. » (Lettre, GS V, 265, Lettres, p. 135)
« Les idées de substantif et de verbe se mêlent et se confondent nécessairement dans les phrases chinoises ; la même particule sert à séparer, comme signe du génitif, un substantif d’un autre, et comme particule relative, le sujet du verbe. » (Lettre, GS V, 268, Lettres, p. 139)
Cette « autre manière » est la position des mots dans la phrase, mais le mot en lui-même ne se trouve nullement modifié par cette position, et donc par la fonction grammaticale qu’il occupe. Si on compare ce système aux langues à flexion, on peut dire que la langue chinoise fonctionne comme si elle ne contenait que des radicaux ; la désinence, marque de la relation grammaticale, est absente : « Tous les mots chinois, quoique enchaînés dans une phrase, sont in statu absoluto […]. » (Lettre, GS V, 264, Lettres, p. 135) Mais si les mots restent des termes absolus, il ne faut pas en conclure que la phrase chinoise n’exprime aucune relation entre ces termes. L’expression linguistique suppose naturellement une combinaison des éléments, qui ne restent pas simplement juxtaposés. Mais la relation (et avec elle la grammaire) est entièrement extérieure aux termes eux-mêmes, elle est uniquement dans l’entre-deux, c’est-à-dire dans la position des termes les uns par rapports aux autres. Mais il ne suffit pas de parler de position. Après tout, des langues sans déclinaison, comme le français, fixent aussi partiellement la fonction grammaticale des substantifs par la place dans la phrase ; c’est la place qui différencie le sujet du complément. Cependant dans ce cas la position sert uniquement à différencier la fonction de termes qui sont déjà, en eux-mêmes, spécifiés dans leur nature. Le substantif peut être sujet ou complément, mais il se distingue dans sa forme d’un verbe, et si la fonction est indiquée par la place du substantif, elle est, plus fondamentalement, appelée par le verbe, qui demande un sujet, et attend un complément. La position est seconde par rapport à la différenciation de la nature du mot, qui est immédiatement grammaticale. C’est le mot qui, dans sa forme, appelle un autre mot et suscite la phrase. La forme est liée à la structure.
La situation du chinois est tout autre : la distinction entre la nature et la fonction est seconde ; puisque l’une et l’autre sont définies en même temps par la position dans la structure formelle de la phrase, dont l’ordre est indépendant des termes qui viennent la remplir. « Le chinois range les mots des phrases dans un ordre déterminé, et la distinction fondamentale sur laquelle repose cet ordre, consiste en ce que les mots qui en déterminent d’autres, précèdent ces derniers, tandis que les mots sur lesquels d’autres se dirigent comme sur leur objet, suivent ceux dont ils dépendent. » (Lettre, GS V, 266, Lettres, p. 137)
Humboldt revient sur ce point quelques pages plus loin, en s’appuyant sur la Grammaire d’Abel-Rémusat : « la position des mots ne marque point proprement les formes grammaticales des mots, mais se borne à indiquer quel est le mot de la phrase qui en détermine un autre » (Lettre, GS, V, 278-279, Lettres, p. 149.)
La structure précède la forme, qu’elle force à entrer dans son à son ordre. Le rapport de voisinage entre un terme et un autre n’est pas appelé par le progrès de la pensée mais par les contraintes de la détermination d’un terme par l’autre. L’analyse grammaticale consiste alors à dégager les ordres de détermination, en repérant les termes déterminants et en y rattachant les déterminés ; elle procède exactement comme l’analyse d’une formule algébrique, en considérant les opérations entre les termes sans prendre en considération le contenu des termes eux-mêmes, laissés, dans leur formule symbolique, à leur valeur absolue. La phrase chinoise est un modèle de logique ; elle procède selon la rigueur d’un système symbolique. Mais c’est un système dont les opérations elles-mêmes ne sont pas indiquées comme telles, mais seulement induites par la position des termes (comme la multiplication dans l’algèbre).
Cette spécificité de la langue chinoise conduit à s’interroger sur la notion même de grammaire. La langue chinoise a-t-elle une grammaire ? S’il est incontestable qu’elle est réglée par des lois strictes de construction, ces lois relèvent-elles d’une grammaire ? Tout d’abord, qu’entend-on exactement par grammaire ? La grammaire est-elle une structure de l’énoncé linguistique, plus fondamentale que tout énoncé, qui pourrait être définie indépendamment de tout énoncé spécifié dans sa forme ? En ce sens le chinois a une grammaire, même si elle ne peut être décrite selon les mêmes termes que la grammaire des langues à flexion. Mais une telle structure n’est plus alors réductible aux règles descriptives de l’usage, dont nous faisons les rudiments d’un apprentissage scolaire. Elle ne correspond plus non plus à ce qui s’est historiquement constitué, dans la tradition du logos occidental, à partir de l’analyse des fonctions morphologiquement marquées et des parties du discours. Par conséquent cette structure formelle, symbolique et non rhétorique, contredit la problématique humboldtienne du langage, et avec elle le logocentrisme dont elle est l’expression.
La difficulté qui se fait jour n’est ni verbale ni limitée à la question linguistique. C’est la définition même de la raison qui est en jeu. Soit le chinois a une grammaire, alors il faut comprendre la rationalité de la langue – et son lien à la pensée – à un niveau qui ne correspond pas à la visée intentionnelle du locuteur, à sa pensée consciente, directement extériorisée dans les sons. La grammaire est dans ce cas une écriture, inconsciente. Mais alors la raison n’est pas le logos qui s’identifie au discours qu’il forme – et toute la genèse envisagée par Humboldt vers le point de culmination du logos s’effondre. Inversement si, avec Humboldt, on tient la raison pour la pensée maîtresse d’elle-même et de sa forme, la manifestation immédiatement sensible de l’intériorité intelligible, qui se particularise dans ce que les grammaires occidentales appellent les « parties de l’oraison », alors il faut admettre que les Chinois se tiennent à l’extérieur de cette présence à soi, qu’ils ne font pas le même usage de la raison que les Grecs et leur descendants spirituels.
Humboldt a vu cette difficulté dès 1822. Ce qui est en cause, c’est la notion même de diversité, qui doit comporte une plasticité si large qu’elle englobe toutes les langues dans leurs différences et leurs particularités nationales, et néanmoins une unité dans laquelle l’identité de l’humanité se réfléchisse. Le premier écueil est de laisser s’effondrer la perfection des Grecs, et donc du logos, dans une identité qui inclut les Chinois ; le deuxième est de transformer la diversité en différence, et de perdre l’humanité des langues. Humboldt cherche une solution qui tienne à la fois l’universel et le particulier de la grammaire. C’est à nouveau le concept d’energeia qui fait le lien entre les opposés. Celui qui est fait pour chanter ne sait peut-être pas chanter. Il est chanteur et il ne l’est pas. Ainsi il y a une grammaire implicite à la langue, et il suffit pour lui donner une forme déterminée d’énoncer des règles que tout le monde utilise, que tout le monde connaît sans les connaître ; de même qu’il existe une logique naturelle que toute pensée met en œuvre lorsqu’elle cherche la cohérence, sans avoir besoin pour cela d’appliquer les règles de la logique formelle. Mais il ne peut y avoir de grammaire constituée que là où la langue contient déjà des formes grammaticales. Il est donc naturel que ce soit la langue la plus grammaticalement formée (le Grec) qui donne naissance à la première grammaire [Cette évidence doit cependant être nuancée lorsqu’on prend en compte la genèse laborieuse d’une telle grammaire. Cf. Frédérique Ildefonse, La Naissance de la grammaire dans l’Antiquité grecque, Paris, Vrin, 1997]. Inversement, là où il n’y a pas de formes grammaticales, il ne peut y avoir de grammaire explicite. C’est pourquoi Humboldt s’interroge sur la pertinence de recourir au terme de grammaire pour décrire les règles de formation du discours chinois : « Chaque peuple comprend sa langue, quelle qu’elle soit, grammaticalement, et ne saurait la comprendre autrement. Mais il ne suit pas de là que la langue chinoise possède ce que nous nommons grammaire, et même pas ce qu’on doit nécessairement nommer ainsi. » (Lettre à Abel-Rémusat du 6 juillet 1827, Lettres édifiantes p. 248)
La première grammaire chinoise, rédigée par un chinois selon un modèle occidental et non par un missionnaire, date seulement de 1898. Il s’agit du Ma shi wen tong (Principes de base pour décrire clairement et de manière cohérente) de Ma Jianzhong (1844-1900). Cf. Alain Peyraube, Sur les sources du Ma Shi Wen Tong, Revue Histoire Epistémologie Langage, 1999, vol. 21, fasc. 2, pp. 65-78
Mais la phrase citée fait apparaître un autre sens de la grammaire. A côté de la grammaire constituée comme discipline linguistique spécifique, sur la base de formes grammaticales explicites, comme celles qu’on rencontre dans les langues à flexion, la grammaire définit, plus fondamentalement, la structure même de la langue qui l’organise en discours. En ce sens élargi, il y a une grammaire dès qu’il y a une intention de signifier, une pensée formulée dans une combinaison de signes dans une unité signifiante globale. Il y a grammaire dès qu’il y a compréhension. La grammaire est inhérente à la langue comme fait primitif de l’homme. La langue chinoise, en tant qu’elle est précisément une langue, et rend possible la compréhension, a une grammaire. « La langue chinoise a certainement une grammaire fixe et régulière, et les règles de cette grammaire déterminent, à ne pas pouvoir s’y méprendre, la liaison des mots dans l’enchaînement des phrases. » (Lettre, GS V, 292, Lettres, p. 163) On peut donc dire à la fois que la langue chinoise a et n’a pas une grammaire selon qu’on entende ce terme dans son sens strict, historique, ou dans son sens élargi.
La différence entre l’implicite et l’explicite, elle-même comprise à partir de la différence entre la puissance et l’acte, permet donc de résoudre le problème de la grammaire des Chinois. On ne peut nier qu’ils se comprennent, et qu’il existe donc des règles des la compréhension, même si elles ne sont pas exprimées dans une grammaire. Cette solution présente l’intérêt de faire de l’explicite, donc des Grecs, le fondement de l’implicite, donc des Chinois, puisque la puissance ne se comprend, comme l’a montré Aristote, qu’à partir de l’acte, à qui revient la primauté. Mais cette solution rend le terme de « grammaire » équivoque ; elle évite l’amphibologie, mais ce n’est pas sans soulever un problème. En effet si « la liaison des mots dans l’enchaînement des phrases », qui est rigoureuse en chinois, définit une grammaire (sens élargi), cela implique qu’il est possible, pour une langue, d’avoir une structure grammaticale sans que celle-ci se traduise par des formes grammaticales, ni même par des catégories grammaticales, donc par une grammaire (sens strict).
« Je nomme catégories grammaticales les formes assignées aux mots par la grammaire, c’est-à-dire les parties d’oraison et les autres formes qui s’y rapportent. » (Lettre, GS V, 257, Lettres, p. 126)
Or une telle distinction contredit l’explication génétique des structures grammaticales, qui privilégie les formes grammaticales authentiques dans la formation de la pensée, et donc en fait la marque distinctive des langues bien formées.
C’est la position centrale de l’Enstehen. « […] bien que l’esprit aspire toujours et partout à l’unité et à la nécessité, il ne peut développer l’une et l’autre que progressivement à partir de lui, et seulement à l’aide de moyens plus sensibles. Parmi les plus utiles de ces moyens, il y a pour lui la langue qui nécessite, en raison de ses fins les plus conditionnées et les plus basses, la règle, la forme et la légalité. Plus il trouve formé en celle-ci ce qu’il aspire aussi à trouver pour lui-même, et plus intimement il pourra s’unir à elle.
Si l’on considère à présent les langues selon toutes les exigences dont elles font ici l’objet, elles ne les satisfont (ou les satisfont remarquablement) que si elles possèdent d’authentiques formes grammaticales et non des analogues de celles-ci, et cette différence se manifeste ainsi dans toute son importance. » (Entstehen, GS, IV, 308, Lettres p. 98)
Et plus loin : « Quoi que l’on puisse dire en partant de là de l’aptitude d’une langue qui n’est pas formée grammaticalement de la sorte pour le développement des idées, il demeure toujours très difficile de comprendre qu’une nation puisse parvenir d’elle-même à une haute culture scientifique sur la base inchangée d’une telle langue. » (Entstehen, GS, IV, 309-310, Lettres p. 99)
Humboldt ne peut maintenir l’universalité de la structuration des langues par la grammaire, qu’en situant cette assise fondamentale à un niveau qui n’est plus celui de la forme. La grammaire est fondamentalement non plus la forme d’une langue – car des langues peuvent se passer de ces formes – mais la structure même de la pensée (Cf. Jürgen Trabant, « la linguistique de la structure », in Humboldt ou le sens du langage, Bruxelles, Mardaga, 1992, pp. 152 sq). « Les rapports grammaticaux existent dans l’esprit des hommes, quelle que soit la mesure de leurs facultés intellectuelles, ou, ce qui est plus exact, l’homme en parlant suit, par son instinct intellectuel, les lois générales de l’expression de la pensée par la parole. » (Lettre, GS, V, 284, Lettres, p. 154) Et Humboldt donne à cette structure universelle le nom de « grammaire innée » (Lettre à Abel-Rémusat du 6 juillet 1827, Lettres édifiantes, p. 246-247 ; une telle grammaire est à rapprocher de la grammaire générative de Chomsky.). Or la langue chinoise, si elle est la plus éloignée des formes grammaticales, présente au contraire une algèbre fondamentale plus proche de cette grammaire innée. Mais la primauté de la structure sur la forme, de l’écriture sur la parole, de l’inconscient sur le conscient, bouleverse la « logique » grecque, celle de la présence à soi de l’esprit dans sa propre extériorisation à soi.
Humboldt, pour résoudre le problème posé par la Chine, transforme le concept même de grammaire en l’élargissant, de façon à pouvoir y inclure la Chine.
C’est à un tel élargissement que l’invite Abel-Rémusat lui-même. Il importe de souligner que l’objection du chinois n’est pas formulée par un sinologue, mais par le philosophe du langage lui-même. Si Abel-Rémusat relève cette objection il veut surtout éviter de faire du chinois une exception. Le chinois ne constitue une anomalie qu’à partir d’une règle qui est définie du point de vue occidental, c’est-à-dire grec. Mais la familiarité du sinologue avec le chinois le conduit à contester la valeur absolue de ce point de vue, et par là même à réduire la différence ou l’étrangeté du chinois. L’éloignement du chinois ne constitue pas une altérité radicale. Elle doit au contraire inciter à définir autrement, à partir d’une universalité élargie, la notion même de grammaire. La langue chinoise « semble propre à agrandir, si l’on ose ainsi parler, le champ de la grammaire générale » (Compte rendu du Journal Asiatique, Lettres, p. 123). La Chine n’existe dans sa radicale différence que pour celui qui ne la connaît pas. Mieux la connaître conduira à transformer la notion même de grammaire, et par là même de raison, à abandonner le primat logique. Humboldt relève le défi ; il accepte cet élargissement, redéfinit la notion de formes grammaticales, mais sans adopter le nouvel universalisme que lui suggère Abel-Rémusat.
Il en résulte qu’au lieu d’envisager le processus grammatical comme un progrès graduel vers l’accomplissement de la forme, il le situe entre deux pôles dont l’un est une langue qui exprime phonétiquement l’exposant grammatical (grammaire au sens strict), l’autre une langue de l’algèbre littéral (grammaire au sens large). Le premier pôle est représenté par le sanscrit, l’autre par le chinois.
« […] le chinois et le sanscrit forment les deux points terminaux qui délimitent l’ensemble du domaine linguistique qui nous est connu, sans avoir respectivement la même aptitude au développement de l’esprit, mais la même cohérence et la même consistance achevée de leur système. » (Verschiedenheit, GS VII, 274)
L’unité de l’idée d’homme est ainsi sauvée par la notion de grammaire, mais au prix d’une distorsion qui laisse subsister un problème. D’une part l’unité de la grammaire est apparente, et renferme une contradiction. D’autre part l’étrangeté du chinois n’est pas entièrement conjurée. En effet il paraît très discutable de rendre compte de la structure logique qui régit l’ordre de la phrase chinoise par un terme dont l’usage le plus courant renvoie, chez Humboldt en particulier, à la rhétorique et à la dialectique de la langue grecque. Car ce que fait apparaître le chinois, c’est précisément un ordre qui échappe au logos, tel qu’il s’est déployé dans la tradition métaphysique, dans le raisonnement logique, et dans l’analyse linguistique. Par la notion de grammaire, Humboldt s’efforce d’inscrire l’irrationalité chinoise dans la rationalité grecque, mais il fissure par là cette rationalité elle-même.
Nous développerons maintenant ce point en explicitant le deuxième caractère de la Chine, contradictoire avec le premier, à savoir sa richesse culturelle, et en particulier celle de sa littérature fondée sur les lettres (le terme est évidemment impropre pour une langue graphique qui ne connaît pas l’alphabet).
On s’accorde en effet à reconnaître à la Chine l’excellence de sa tradition lettrée. Telle est précisément l’origine de l’objection que nous indiquions en commençant : comment une langue peut-elle donner naissance à une « littérature florissant depuis des millénaires » (Enstehen, GS IV, 311, Lettres, p. 100) quand elle n’a pas de formes grammaticales authentiques ?
En réalité pour Humboldt – et c’est ainsi qu’il répond dans un premier temps, c’est-à-dire dans le mémoire de 1822 – l’objection est apparente. « Si deux des peuples les plus remarquables [le copte compris comme « langue des anciens Egyptions » s’ajoute au chinois] ont été en mesure d’atteindre le niveau de leur culture intellectuelle avec des langues qui se passaient tout à fait ou très largement de formes grammaticales, cela paraît [nous soulignons] soulever une objection importante contre l’affirmation de la nécessité de ces formes. » (Ibid.) L’objection n’en serait une que si le fait de posséder une riche littérature était à soi seul le signe décisif d’un haut niveau de culture intellectuelle. Mais ce n’est pas le cas. En effet la véritable preuve d’accomplissement de la pensée n’est pas l’écriture, mais l’art du discours. « Car il est indéniable que c’est dans l’exposé dialectique et rhétorique que se montre avec le plus d’éclat la rapidité et l’acuité de la pensée » (Enstehen, GS IV, 311, Lettres, p. 101) ; or il y a loin entre une littérature dont le style est, même aux yeux de ses admirateurs « trop indéterminé et haché » (Ibid.) et « la langue la plus cultivée que nous connaissons, la langue grecque » (Enstehen, GS IV, 294, Lettres, p. 86). L’argument tiré des lettres chinoises se retourne contre la Chine. Nul plus que Humboldt n’a défendu l’idée que le logos, la pensée se présentifiant dans la langue, s’incarnait dans la sonorité. C’est uniquement dans l’expression vocale que le logos trouve l’unité de la richesse et de la vivacité qui accomplit son energeia. La lettre renvoie au son qui la précède et la fonde, bref « qui est la véritable langue » (Lettre, GS V, 301, Lettres, p. 172). La lettre est au mieux la transcription du son, mais elle en est en même temps le tombeau, ou la prison.
Le terme de tombeau est directement associé en grec au signe plus particulièrement à l’écriture incorporée au signe lui-même. Cf. Jacques Derrida, « Le puits et la pyramide », in Marges de la philosophie, Paris, éditions de minuit, 1971, pp. 79-127 ; sur l’écriture chinoise pp. 118-123.
« La formation d’une littérature équivaut à la formation des points d’ossification dans le corps humain vieillissant, et à partir du moment où le son, s’épanchant librement dans le discours et le chant, se trouve banni dans le cachot de l’écriture, la langue passe d’abord par une prétendue purification, puis s’appauvrit et finalement se meurt, pour riche et répandue qu’elle soit. Car la lettre a un effet pétrifiant sur le discours parlé qui se poursuit encore quelque temps à ses côtés, libre et varié. » (« De l’influence de la diversité de caractère des langues ê la littérature et la culture de l’esprit », GS, VII, 642, traduction Denis Thouard, in Sur le caractère des langues, Paris, Seuil, 2000, p. 127)
Or la littérature chinoise ne se contente pas de pétrifier le son, elle en devance l’émission et en règle la production. La logique algébrique qui règle la phrase chinoise est un symbolisme d’écriture. En effet c’est le propre de l’écriture de réduire la richesse du son à un simple chiffre qui n’en conserve que le squelette. L’écriture réduit la continuité du discours à une succession d’éléments discrets. Mais le chinois va plus loin : alors que l’écriture alphabétique épouse autant que possible la plasticité du logos, les caractères chinois, livrés à eux-mêmes par l’absence de formes grammaticales, constitue à eux seuls une langue autonome. La Chine se singularise en effet le dédoublement de son système linguistique, la langue écrite constituant à elle seule un système autonome, indépendant de la langue orale. Or cette situation véritablement « anomale » (Verschiedenheit, GS VII, 277) – car la légalité est représentée par la parole – a été rendue possible par l’absence de formes grammaticales.
« Si les considérations précédentes ont reconnu à bon droit une forme linguistique comme la seule légale, alors cet avantage repose seulement sur le fait que, par une conjonction heureuse d’un organe fin et riche avec la force vivante du sens linguistique toute la disposition que l’homme porte en lui, dans son corps et son esprit, en vue de la langue, se développe complètement et infailliblement dans le son. » (Verschiedenheit, GS VII, 276)
« Comme la langue parlée n’entrelaçait jamais les sons les uns avec les autres, il était moins nécessaire de lui donner une désignation singulière. Selon ce que l’oreille percevait des monogrammes du son, furent imités les monogrammes de l’écrit. » (Verschiedenheit, GS VII, 273)
Il ne faut pas s’étonner qu’une langue qui ne peut pas s’incarner dans la sonorité, sécrète, comme un prolongement de sa propre stérilité, une écriture qui est un tombeau, et une civilisation de lettrés. Faute de pouvoir se développer en parole, qui est un flux de pensées, le chinois présente avec vigueur des collections d’idées – dont on ne sait pas quoi faire, parce qu’on ne voit pas comment les animer de sens.
« …comme l’on ne met point à la place du son l’image d’un objet réel (comme dans les hiéroglyphes), mais un signe conventionnel, choisi à cause de sa relation à l’idée, l’esprit doit se tourner entièrement vers l’idée. » (Lettre, GS V, 301 ; Lettres, p. 173)
Non seulement le système linguistique chinois est dédoublé en deux langues indépendantes, mais l’écriture ne cesse d’interférer sur l’oralité, bouleversant l’ordre normal de dépendance.
« … cette écriture a dû influer considérablement, et doit influer encore sur l’esprit, et par là également sur la langue des Chinois. » (Lettre, GS V, 300, Lettres p. 172)
En effet la langue orale étant composée de monosyllabes indécomposables et en compositions limitées, seule l’écriture permet de faire apparaître les rapports entre les mots, par la présence d’éléments graphiques isolables qui renvoient à d’autres mots. C’est ainsi que le sens de la langue, qui passe par l’étymologie et l’analyse des éléments, n’est accessible qu’à travers l’écriture. Celui qui sait lire et écrire se détourne du son pour lui substituer immédiatement l’écriture et l’ensemble des rapports d’idées qu’elle véhicule.
Le lettré chinois est donc dépositaire du sens de la langue. C’est uniquement à partir de l’écriture que « les Chinois […] doivent regarder le langage en général. » Contrairement au lettré grec, qui est seulement l’herméneute de la parole, et vise avant tout à perfectionner la rhétorique, le lettré chinois a accès à un univers linguistique fermé au simple locuteur. Cela fonde sa supériorité à la fois naturelle et politique.
Mais Humboldt relève que cette influence de la langue graphique sur la langue orale ne peut pas être due à une antériorité de la première sur la seconde. Comme partout ailleurs l’écriture suit la parole et s’adapte à elle. Cette antériorité pourrait contredire le primat chinois de l’écriture, si Humboldt ne retournait l’objection : si la langue écrite influence la langue orale, c’est parce que celle-ci est déjà marqué par les traits qui caractérisent l’écriture : « la langue avait déjà cette forme [consistant à juxtaposer les termes sans marquer les relations entre eux] avant l’écriture » (Lettre, GS V, 302, Lettres p. 174). La pauvreté phonétique du chinois imposait une économie de moyens dans l’expression des relations entre les termes, donc dans l’usage des termes grammaticaux explicites. La relation entre les idées est pensée indépendamment de tout signe pour la marquer, grâce à « un talent heureux de manier méthodiquement les idées » (Lettre, GS V, 304, Lettres p. 176). Le génie particulier du chinois n’est pas propre à l’écriture, mais celle-ci l’amplifie de telle sorte qu’elle devient pour le chinois comme une seconde nature ; l’écriture « est devenue inhérente à la langue même » (Ibid.).
Cette appropriation entre l’écriture et la langue conduit à relativiser l’idée d’un double système linguistique chinois. L’écriture n’y est pas d’une autre nature que la parole. On rejoint alors la situation des langues à alphabet, mais pour une raison diamétralement opposées : dans celles-ci, la similitude entre l’écriture et la parole vient de ce que la première imite la seconde ; en chinois à l’inverse, la langue orale possède déjà le caractère de l’écriture.
Le sinologue demandait qu’on ne surévalue pas, dans l’appréciation de la grammaire chinoise, le rôle joué par l’écriture, et qu’on considère d’abord la langue chinoise comme telle, dans sa forme orale (Cf. Abel-Rémusat, Observations sur quelques passages de la lettre précédente [= Lettre de Humboldt à Rémusat], note 13, Lettres, p. 187). Mais l’examen de celle-ci conduit à un constat plus radical encore puisque la fossilisation de la langue (et donc son éloignement du modèle rhétorique grec) se trouve inscrit dans son génie propre, et ne provient pas de l’influence extérieure de l’écriture. « […] c’est le génie de la langue qui détermine l’écriture. » (Lettre de Humboldt à Rémusat du 6 juillet 1827, Lettres p. 251) L’excellence chinoise, qui semblait contredire la pauvreté de sa grammaire et celle de ses possibilités phonétiques – les deux étant liées – les confirme : les lettres ont porté à la perfection l’esprit chinois en changeant en avantage ce qui se donnait d’abord comme une imperfection. Le maniement des idées abstraites, le goût de la classification, l’association de représentations purement intellectuelles, font du chinois une langue de l’entendement (Cf. Lettre à M. Abel-Rémusat, Lettres, GS V, 304, p. 176).
Dans son cours de 1827 sur l’Histoire de la philosophie, Hegel s’appuie à plusieurs reprises sur Humboldt pour affirmer que les Chinois s’en tiennent à l’abstraction d’entendement, mais ne s’élèvent jamais jusqu’au concret dialectique (cf. Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome II, traduction Gibelin, Gallimard, collection Idées, 1954, pp. 90-100). Derrida, en citant ses passages dans « le Puits et la pyramide » (op. cit. pp. 120-123) souligne que le procès de la Chine est aussi bien le procès de l’écriture symbolique, du formalisme mathématique. Hegel fait plusieurs fois référence à Humboldt (Lettre à Abel-Rémusat de 1827), mais aussi, indifféremment, à Abel-Rémusat. Hegel partage incontestablement avec Humboldt une conception phonocentrique du logos, et donc la préférence pour l’écriture alphabétique. « Un tel procès [fait à la Chine] est du moins conséquent avec le système qui lie le logos avec l’écriture alphabétique, dès lors qu’il est pris comme modèle absolu. » (Derrida, op. cit., p. 122) Cependant il n’est certain que le primat du son s’appuie sur les mêmes raisons chez Hegel et chez Humboldt. Pour ce dernier le modèle est toujours la rhétorique attique, le discours politique qui fait un effet sur la pensée dans la présence à soi de la cité. La présence est politique. A l’opposé Hegel ne voit dans la sonorité l’extériorisation parfaite de l’intérieur que parce qu’elle est évanouissante, et se laisse ainsi à la fois dissoudre et relever par la pensée (cf. Encyclopédie, Addition au § 462). Car il importe à la pensée qu’il n’en reste rien, qu’elle soit entièrement brûlée dans l’holocauste du sens. Le modèle dans ce cas, est chrétien plutôt que grec. Toutefois il est aussi bien philosophique plutôt que politique ; car le philosophe, Socrate, est aussi dont la parole a été consommée dans la mort.
Le dialogue que Humboldt engage avec Abel-Rémusat au sujet de la Chine a pour conséquence un léger déplacement de la portée de l’objection chinoise, il n’est modifie pas la structure. Les réserves du sinologue viennent de ce que le système humboldtien de classification des langues à partir de la grammaire, présuppose une exception de la Chine, son idiotie, son altérité – qu’on la blâme ou qu’on la loue. Cette altérité est associée au système de l’écriture, et à la tradition lettrée qui semble en être le prolongement.
Jean-François Billeter fait remonter le « mythe de l’altérité de la Chine », aux Jésuites, qui ont transcrit une image de la Chine que leurs interlocuteurs privilégiés, les mandarins défenseurs de l’idéologie impériale, ont voulu donner d’eux-mêmes (Cf. Contre François Jullien, Paris, éditions Allia, 2006). L’altérité est donc le voile chargé de mystères qui cache un discours de légitimation politique du pouvoir chinois. La sinologie, comme discipline critique, évite les effets de fascination ou de rejet qui ont une origine politique et idéologique.
Comprendre, c’est alors réduire l’altérité, et pour cela relativiser l’importance de l’écriture. Humboldt accepte d’entrer dans cette familiarité avec la Chine et ainsi d’atténuer l’écart qui la sépare de la Grèce. Il procède à une nouvelle évaluation, qui fait une part plus large au génie de la langue chinoise. Il procède également, comme on l’a vu, à un élargissement des concepts théorique, qui permet de faire entrer la Chine dans le champ d’une grammaire générale. Mais ces remaniements sont seulement des ajustements qui permettent de sauver deux postulats fondamentaux : l’actualisation de l’idée d’homme dans la diversité des langues et la supériorité du logos sur l’écriture.
Le remaniement aboutit, dans la Verschiedenheit (GS VII, 271 sq.), à repenser la formation des langues dans un système régi non plus par une progression linéaire vers un telos unique, mais par une polarité chinois-sanscrit. Cette opposition traduit exactement celle de l’écriture et le phonétisme. Le grec n’est plus un telos, il se trouve apparemment au centre d’une structure. Mais cette polarité entre laquelle se placent toutes les autres langues, renferme un déséquilibre. La perfection représentée par le logos grec se rattache entièrement au pôle du sanscrit. Humboldt ne l’explique pas par une origine historique commune, mais par le même traitement formel de la grammaire. Par conséquent, si le chinois est pensé comme une possibilité fondamentale de la faculté linguistique humaine, il n’en reste pas moins marqué par son « anomalie ».
La Chine demeure une exception.
« J’avoue que, bien loin de croire que la grammaire chinoise forme, pour ainsi dire, le type du langage humain, développé dans le sein d’une nation abandonnée à elle-même, je la range au contraire parmi les exceptions. » (Lettre, GS, V, 299 ; Lettres, p. 171)
La première formulation de l’objection chinoise, marginale, dans le mémoire de 1822, se fonde sur une représentation encore très sommaire et peu informée de la langue chinoise. La Chine est mise en position d’exception avant même d’être connue. Cela peut simplement relever d’un préjugé, présent dans le terme même de chinois, qui veut dire étrange, compliqué, incompréhensible. Humboldt a plus d’une fois montré sa capacité à se défaire des préjugés nationaux (cf. l’appréciation très positive des langues d’Amérique dans « Über den Dualis », GS VI, 6-7, note). Mais le cas de la Chine semble particulier : elle comporte une part irréductible d’étrangeté, qu’aucune familiarisation ne vient supprimer. Tout se passe comme si, à côté du concept de la Chine, que la sinologie permet de développer et d’enrichir, on avait affaire à une idée, autrement dit une position de la raison qui ne définit pas un objet de l’intuition mais un terme que l’on doit nécessairement se donner pour penser. Il n’est pas nécessaire de connaître la Chine pour en avoir une idée, qui n’est pas une simple imagination ou fiction, mais constitue un point hors d’atteinte que la raison se donne pour penser ses propres limites. En réalité, « la Chine » n’existe pas. Humboldt part d’une idée de la Chine, qui continue d’être active même lorsqu’il étend et remanie son concept. Cette motivation vient de l’intérêt philosophique, voire de la position métaphysique, qui anime et sous-tend la réflexion sur la langue. Selon Derrida, « la grammaire du logos [que défendent Hegel ou Humboldt contre la grammaire de l’écriture] se confond avec le système de la métaphysique » (op. cit. p. 122). Si on veut appeler métaphysique l’onto-théologie de la présence, et faire du logos son accomplissement historial, alors il faut ajouter que l’écriture chinoise, comme langue indépendante de la parole, est l’autre de la métaphysique non pas en ce sens qu’elle lui serait opposée, mais en ce sens qu’elle est l’autre à partir duquel la métaphysique peut poser sa propre identité. La Chine est bien une invention métaphysique, qui a peu à voir avec les Chinois. La sinologie est là pour mettre en garde contre la confusion ; de la même façon que l’anthropologie rappelle qu’il n’y a pas d’homme. Si la Chine et un irrationnel, celui-ci n’est constitué comme tel qu’à partir d’une rationalité qui lui sert de mesure. Il n’y a d’irrationnel que pour la raison. C’est pourquoi la Chine est, dans le système des langues décrit par Humboldt, tout à la fois comprise, mais assignée dans une place qui est celle de l’autre. La métaphysique désigne un désir, qui se constitue à partir d’une différence. Le désir de la Chine, sans lequel l’altérité ne serait pas pensée, est métaphysique. La métaphysique ainsi comprise, n’est pas réductible au système de la présence ; elle est en même temps, avec les contradictions et les tensions que comporte cette simultanéité, une pensée de ce qui excède la présence, une pensée de la limite, et en particulier de sa propre limite, et de ce qui transcende cette limite.