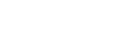Tout juste quarante ans avant l’actuelle Exposition universelle de Shanghai se déroulait à Osaka la vingt et unième édition dont le thème était : le « Progrès humain dans l’harmonie ». Pour le Japon, le redressement économique est enfin acquis après les douloureuses années qui suivirent la destruction matérielle et morale du pays. Le discours des dirigeants japonais s’écrit sur fond d’idéal pacifique où toute politique militariste est condamnée. Le militarisme est honni de tous, nationalisme et patriotisme sont bannis du vocabulaire. En novembre de la même année, l’écrivain Mishima Yukio, escorté par sa milice personnelle, s’inscrit définitivement en marge de ce qui définit dorénavant le Japon nouveau. Il se donne la mort, selon le rituel ancestral du seppuku [1], à l’intérieur même de la base des forces armées du Japon, dans le bureau du général en chef.
Ce qui vient au regard, outre le symptôme et les évidences pathologiques, est la dimension sociale recouvrée par cet acting out [2], aussi marginal soit-il dans sa revendication politique. Avec le seppuku, Mishima se replace dans la lignée des ancêtres samouraïs, mais il n’y sera convié, à cet état de « mieux-être » tant désiré, qu’au prix de la mort. C’est donc sur la base du paradoxe de cette inscription subjective que le présent article voudrait réfléchir, dont le nœud est à situer dans la relation particulière qu’entretient le sinogramme (au fondement de l’écriture japonaise) avec le corps.
Malgré l’apparente distance dite « culturelle » qui nous sépare de ce système d’écriture et de pensée, de ces codes sociaux, nous ne sommes pas moins ici, avec Mishima, au cœur même du Trieb freudien, dans ce qui fonde la condition moderne du sujet divisé entre réalité politique et fantasme. Les formations de l’inconscient sont bel et bien à porter de main avec l’écriture chinoise et cette dernière s’est avérée être un support fondamental pour toute une génération d’artistes japonais en quête d’identité après les bouleversements politiques et sociaux qu’ils ont connu au cours de la première moitié du XXe siècle.
La question du sujet divisé ressort, à juste titre, pour le Japon avec la littérature foisonnante d’après-guerre, période durant laquelle le processus de changement amorcé sous la tutelle des États-Unis, fut plus ample encore que la restauration des Meiji [3]. Nous sommes entraînés au cœur des métropoles en ruine où les écrits s’engagent jusqu’au ravage de l’être. Doute identitaire d’autant plus prégnant que The American way of life continue son ouvrage sans se préoccuper du sujet japonais pour qui « destruction » et « création » ne sont plus fondamentalement antinomiques.
En sondant la substance du roman moderne, notamment avec Cervantès, Milan Kundera a su mettre en exergue ce doute – à l’origine de l’acte délirant – dépourvu de tout jugement, qui serait constitutif de la modernité, de l’être oublié :
Dans ce ou bien – ou bien est contenu l’incapacité de supporter la relativité essentielle des choses humaines, l’incapacité de regarder en face l’absence du Juge Suprême.
(Kundera, 1995, p 18)
Pour prendre un autre exemple célèbre, nous retrouvons également dans Le double de Dostoïevski avec le personnage de Goliadkine le thème du « ceci et cela » sous lequel se dessine une indécision fondamentale à orienter ses actes quant à la réalité. Mais aussi riches en authentiques observations psychiatriques que puissent être certaines œuvres littéraires, comment l’écriture et sa lettre peuvent-elles éclairer la clinique dans sa pratique ?
La lettre est envisagée chez Jacques Lacan comme un véritable fantasme en action qui peut rétablir le lien social. Par le biais du travail d’écriture, l’écrivain convoque la présence d’un élément tiers s’immisçant dans le jeu du regard avec sa propre mère (Autre) — censé avoir lieu lors de la période narcissique de la prime enfance, un jeu à trois qui permet ainsi au corps du sujet d’être lu comme simple lettre, de balayer toute aporie quant à l’image du corps [4] et de s’extirper du corps de la mère. La fonction de la lettre est un nom-du-père.
Ainsi, Mishima Yukio, un nom sinographié suppléant un corps, est exemplaire pour la psychanalyse et plus précisément pour sa visée politique qui est d’une part de désaliéner le sujet du discours de l’Autre – lui faire éprouver le réel de la singularité de sa parole, et d’autre part de l’extirper de la contemplation fondamentale de sa propre image dans le miroir appelée à se répéter dans les relations qu’il tissera dans la trame sociale avec ses rivaux et objets d’amour imaginaires – il s’agit là de lui faire éprouver la semblance du désir humain depuis la structure même de l’énonciation. Au « terme » d’une analyse il revient donc au sujet d’assumer son symptôme pour qu’il puisse trouver sa place en société.
Que Mishima ait fini par se suicider ne contredit en rien la théorie de la suppléance par la lettre développée par Lacan, bien au contraire. D’abord, le fait même que l’auteur n’est jamais donné à voir à son entourage de lourds symptômes socio-psychopathologiques, notamment dans les dernières années de sa vie où le scénario du seppuku était déjà bien établi, et qu’ensuite justement cette mort programmée noir sur blanc coïncide à la fois pour lui, à contre-courant du bain politique, avec le discours de ses ancêtres et avec l’assomption du leurre identificatoire nous révèle massivement ici l’importance de la fonction de la lettre dans la traversée du fantasme et plus particulièrement, c’est le trait de cette recherche, la capacité du sinogramme à fixer un réel hors du sens, hors de la semblance structurée et véhiculée par les couples d’éléments opposés d’un Autre à l’autre.
Car pour que sa tienne du côté du corps, il faut bien que le fantasme ait été traversé par le sujet, enfin du moins supposé traversé par ce qu’instaurent comme voile normatif les noms-du-père. Pour la plupart cela fonctionne, pour d’autres, les non-dupent errent, cela échoue. Alors, il revient à l’écriture de jouer son rôle compensatoire et de dessiner une nouvelle version de ce père inauguralement défaillant.
L’Unheimlich mishimien
Dès la venue au monde, on constate une emprise du symbolique sur le corps du sujet. L’indice de la loi est marqué par la barre du refoulement renvoyant à l’impossibilité d’accéder aux objets de pulsion. Nous avons à faire à un x qui ne peut être que re-présenté. S’il nous est présenté, c’est une ouverture sur l’objet interdit par la loi. Un un est produit à la place de l’objet perdu, il le re-présente, il le symbolise. Il est l’expression même de la coupure pour le sujet.
Le Nom-du-Père vient représenter dans le discours de la mère le manque de cet objet a, c’est ce qui permet à l’enfant de vivre cette destitution de soi-même comme unification et non comme étrangère au corps propre [5]. De ce lieu, pour que l’image fasse une, il faut l’un symbolique. Le signifiant le plus saillant de ce qu’on peut attraper dans le réel de la copulation étant le phallus, l'un re-présenté dans l’ordre du symbolique est donc sexué.
Dans la schizophrénie, ce refoulement n’a pas lieu puisque la mise en place de l’unité signifiante ne se fait pas – le signifiant étant à la fois le symbole du refoulement et de la différence sexuelle, tout le symbolique est réel, le un se réduit à l’objet a. Cependant, des phénomènes compensatoires peuvent permettre de suppléer une structure psychotique, et ce, à partir de l’image d’un signifiant. Le corps peut tenir tout seul comme un simple bâton grâce à cette image. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Lacan utilise lui-même le terme de « virilité » pour rendre compte de la fonction phallique dans sa définition de la suppléance – marquant ainsi la nécessité pour le corps du sujet d’inscrire cet hiatus entre homme et femme :
C’est un mécanisme de compensation imaginaire de l'œdipe absent qui aurait donné au sujet la virilité sous la forme, non pas de l’image paternelle, mais du signifiant, du nom-du-père. [6]
(Lacan, 1981, p. 218)
Si l’image du corps propre finit par ne plus être unifiée, quelque chose ne s’est pas homogénéisé dans la consistance même de ce corps en tant que signifiant. C’est ce que l’œuvre de Mishima ne cesse de nous donner à voir, de l’épisode de l’auto-intoxication de Confession d’un masque (1949) à sa dernière marque esthétique, son seppuku [7] (1970). Bien que la promotion de son art soutienne son corps à l’instar de la publication chez Joyce, la mort se trouve au bout.
Conformément au chemin à emprunter selon l’idéal du guerrier japonais — La voie du samouraï, c’est la mort (Yamamoto, 1999), Mishima tente un retour à l’origine par le seppuku. Ce retour au réel est une tentative de s’inscrire à la place où il est représenté dans le discours de l’Autre concret. Il croit enfin pouvoir connaître le nom de ce qu’il est comme sujet de l’énonciation. Malheureusement, en s’inscrivant dans le silence et la solitude de la mort, le corps redevient signifiant radical, un simple signifiant muet où « aucun signifiant, fut-il réduit à sa forme minimale, celle que nous appelons la lettre, ne saurait se signifier lui-même » (Lacan, 1981, p 21).
Juste après la publication de Confession d’un masque, remportant un succès unanime, Mishima est émotionnellement de plus en plus instable. Désormais, le soutien du corps n’est plus possible, l’image harmonieuse dont il dépendait n’est plus assurée par l’écriture du fait d’être appelé à la place du père réel [8], conséquence de sa réussite littéraire, il jouit à ses dépens du regard de l’Autre. Il entreprend donc un voyage en Grèce pour se détacher de la laideur que lui inspire son corps sous les feux de la rampe. Il y rencontre le soleil, c’est une révélation pour sa chair malade, la surface glauque s’ouvre à la lumière. De cette rencontre se dessine une mise en scène flagrante de son corps, sur d’abord sur le plan imaginaire puis après son mariage, sur une base réelle et symbolique [9].
À partir de 1955, Mishima s’adonne au culturisme. Ces activités appellent de nouveau sur lui l’attention du public. Ces exercices, ne touchant ici qu’à l’image, visent le maintien du corps sous la lumière des projecteurs. Ce n’est qu’à partir de son mariage (1958), lors de sa rencontre avec « l’étrange » qu’appelle cette place, qu’il se lance dans un programme héroïque d’exercices physiques, éprouvant cette fois-ci le corps dans sa matérialité. Tout comme Joyce, Mishima tend vers ce paroxysme de la jouissance par la massivité du signifiant, mais à la différence de l’auteur irlandais il finira par produire une écriture corporelle.
L’écrivain transforme son corps propre en objet supposé perdu, l’impossible se réalise. En tenant cette position phallo-narcissique par la voie réelle du fantasme, Mishima a enfin accès au regard de l’Autre du lieu de l’objet convoité. Mais à trop vouloir se rencontrer, il finira par se perdre dans l’horreur du réel tel le mythe de Narcisse, cette histoire d’amour où le héros finit par si bien se conjoindre avec lui-même qu’il finit par ne plus repérer dans le miroir de la nature sa propre image, celle qui fait une.
Lettre-ange
Une caractéristique de la langue japonaise est d’accéder directement par son écriture au lieu du signifiant – à l’Autre. Ce système idéographique est mixte puisqu’il combine les kanji chinois à des symboles à valeurs strictement phonétique, les kana. Le signifié est conservé d’une langue à l’autre, pour une partie des caractères seulement, alors que le signifiant sonore change. Avec le Japonais nous sommes donc submergés par les formations de l’inconscient, par les flots de Witz – de mots d’esprits, entre phonèmes et sémantèmes.
Un autre point significatif est cette nécessité pour le signifiant de glisser au fil du contexte. Dans un emploi exclusif du terme, « père » se dit chichi — lecture kun yomi purement japonaise, en revanche, dès qu’un autre signifiant vient s’y coller pour signifier autre chose, le signifiant « père » se modifie en fu — lecture on yomi d’origine chinoise, donc étrangère — sans pour autant noter de changement dans l’idéogramme représentant le signifié « père ». Autrement dit, lorsque le signifiant est livré seul à l’Autre, le sujet nippon emploie sa langue « maternelle », tandis qu’on a un semblant de chaîne signifiante se constituant, on fait appel à ce qui est étranger dans la langue, à savoir une lecture calquée sur le signifiant sonore chinois.
Le registre du signifiant se trouve pour ainsi dire éclaté entre écriture et parole. La lettre japonaise laisse transparaître à la surface ce qui du plus profond du corps reste silencieux. Simultanément, le sujet se compose et se décompose. La dimension de ce discours est celle de la métonymie, un manque y est mis en fonction parce qu’il y a un rapport lâche entre signifiant et signifié, provoquant l’équivocité (Groupe franco-japonais du champ freudien, 1988).
La présentification de ce manque dans l’écriture est instituée par la fonction essentielle de l’Empereur comme Autre barré. Un bouchon est ainsi posé sur la question des origines. L’Empereur révèle, tout en l’incarnant, le manque dans l’Autre dont il assure par sa fonction la consistance [10]. À l’instar du lien qui unit l’ange à Dieu le Père dans la religion chrétienne, la conscience du lien (inconscient) serait le trait d’union entre le sujet japonais et l’ultime instance représentée par l’Empereur.
Comme le suggère Lacan pour approcher la psychose, cette figure de l’ange peut nous être utile si nous nous employons à ne pas sous-estimer le « déguisement » inhérent à sa fonction, afin de saisir le signifiant dans son lien au message. En outre, l’ange représentant « la parole du plus haut silence » (Char, 1962), nous pourrions voir en l’instance de la lettre japonaise une singularité angélique, témoin d’une fonction suppléante pour le sujet nippon.
Avant de lever le rideau de chair par seppuku, pour faire entendre ce qui du corps doit être tu, Mishima fait un discours patriotique à l’attention de la garnison présente sur les lieux. Le corps est en pleine action, mais il est un-signifiant, personne ne l’entend. Mishima doit aller jusqu’au bout du rituel pour que le corps-signifiant puisse être porté jusqu’au terme de l’action symbolique. Il doit irrémédiablement s’inscrire dans la généalogie de ses ancêtres par la mort selon l’éthique du bushidô, la voie du guerrier. Son idéal est de rendre visible ses entrailles en les présentant aux rayons du soleil.
Les propos de Georges Bataille à ce sujet résonnent :
La mutilation représenterait l’intention de ressembler parfaitement à un terme idéal caractérisé assez généralement, dans la mythologie, comme Dieu solaire, par le déchirement et l’arrachement de ses propres parties.
(Bataille, 1970)
Dans le sacrifice il est question de se mettre hors de soi pour atteindre la mort. Ceci ne peut passer que par le regard de l’Autre. Par conséquent, en jouissant de son corps Mishima jouit de cet idéal absolu. Il répond ainsi à la question sexuelle et se fait porte-parole du Père où se donne à voir une vérité en exposant ses entrailles au grand jour. Nous insistons encore une fois dessus : il devient pur signifiant, il remonte jusqu’au réel du signifiant radical.
Pourtant, jusqu’à la chute définitive de l’image une compensation de la béance corporelle a su tout de même se réaliser par l’interstice d’un autre nom. D’après l’anthropologie, « le nom — l’identité qui marque la filiation — est l’élément fondamental qui constitue la personne en tant qu’être social » (Héritier, 1996, p. 284). Tout porte à croire ainsi, qu’en changeant de nom, nous touchons à la possibilité de voir s’afficher pour un sujet la marque suppléante d’un lien social recouvré. Le pseudonyme offre à l’écrivain un semblant de place symbolique. C’est l’image d’un signifiant qui l’oriente vers le choix de ce nom.
À l’occasion de la publication du Bois du plein de la fleur (1944), Hiraoka Kimitake — âgé de dix-neuf ans — adopte le pseudonyme de Mishima Yukio, sur les conseils de son maître Shimizu Fumio. Mishima est une ville située au nord de la péninsule d’Izu, avec le double horizon de la mer et du mont Fuji. Le groupe littéraire de la revue Bungei Bunka se réunit d’ailleurs souvent dans cette ville. De plus, le prénom Yukio est très proche du signifiant japonais yuki, la neige. Avec ce nom, l’écrivain modifie son rapport au corps. Il devient le lieu où tourbillonne le sens pour la lettre japonaise, sans rature, tel le signifiant calligraphique. Il devient lettre-ange puisque du lieu de son nom il peut être à la fois celui qui voit son propre corps suppléé du lieu de l’Autre du mont Fuji, mais aussi celui qui tend à contempler, de la ville Mishima, ce lieu interdit de pureté supposée, les neiges éternelles du mont Fuji. Il est pris entre un soi-disant savoir, se leurrant dans le semblant d’un ego recouvré, et l’inaccessibilité de son être porté aux nues. Un vide ressort de ce nom pour un corps.
Identification au tragique & père-version
Le semblant de vérité que lui procure sa rencontre avec le soleil lors de son voyage en Grèce, le protège d’éventuelles blessures qu’autrui aurait pu lui procurer. En ceci nous vient l’exemple de Joyce avec « le phénomène de la raclée » dans le sens où une des portes d’entrée dans la psychose peut être celle du corps. Mais pour Mishima il ne peut plus y avoir de raclée [11]. Il s’est réconcilié avec son corps ou plutôt identifier à son image, assez pour le traiter comme « soi-même ».
De cette façon une compensation imaginaire s’instaure pour pallier le défaut de l’identification primaire au corps propre. Le soleil a définitivement forclos l’évanescence de la passion en acheminant Mishima sur les traces d’un narcissisme purificatoire. Nous sommes ancrés au plus profond de l’imaginaire corporel.
Il faut attendre son mariage pour voir pointer le réel et du coup, voir se profiler la mort :
L’homme donne sa semence à la femme. Alors débute son long voyage indescriptible en direction du nihilisme.
(Mishima, 1966)
Certes, cultiver son corps revient à le rendre viril comme si quelque chose devait se maintenir en surface. Mais il faut aussi y voir un désir de s’affranchir de l’image. Il veut devenir un simple trait et ressentir cette « virilité » — à entendre selon la définition de la compensation imaginaire donnée plus haut — non pas exclusivement par le regard de l’Autre mais aussi de l’intérieur, à partir du réel de ce qui fait signe.
À la douleur éprouvée durant les séances de musculation se dessine pour lui inévitablement la rencontre avec un réel. Nous touchons dans ce cas de figure à la jouissance :
C’est seulement à ce niveau de douleur que peut s’éprouver toute une dimension de l’organisme qui autrement reste voilée.
(Lacan, 1966, p 768)
Avec cette père-version nous nous approchons d’un savoir quant au phallus toujours fuyant, et c’est ce qui détermine au mieux l’appel du réel dans ce choix d’une place à tenir comme « identification au tragique ».
Les règles qui commandent la filiation, lieu dont dépend la reconnaissance de la place de l’enfant dans la famille et la société, sont ancrées dans ce que le corps humain a de plus irréductible : la différence sexuelle.
(Héritier, 1996, p 24)
Dès lors, la question de la place étant problématique pour Mishima, son corps est sollicité dans ce qu’il a de plus réel, au niveau de la question des sexes. S’impose alors pour lui, la nécessité d’écrire le rapport sexuel dans le lieu même du corps, se posant ainsi la question de la fonction phallique corroborée par l’accès à la jouissance.
Le Père c’est le vrai de vrai, le garant que la vérité existe. Cette vérité se retrouve dans l’Einziger Zug qui peut être substitué à tous les éléments dont se constitue la chaîne signifiante. Tout signifiant a de commun cet unique trait — l’idéal du moi, l’identification inaugurale du sujet au signifiant radical. De ce fait, la question phallique revient par l’entremise de cette transmission dont le médium est le corps. Nous pouvons ainsi parler d’événement sexuel pour le seppuku lorsque le trait unaire [12], déparé, laisse son empreinte sur le corporel. Cette nécessité d’un retour au signifiant malmené est la confirmation d’une identification au tragique pour Mishima.
La tragédie apparaît pour lui tel un mythe dans la chute sociale des bushi, guerriers de noble origine. Suite à un décret du shogun en 1863, le junshi [13] est interdit et provoque ainsi un affaiblissement du lien personnel du samouraï à son vassal. S’ajoute à cela, progressivement, le fait que la classe guerrière soit de plus en plus dépourvue de mission militaire. L’image idéale dans laquelle l’ensemble du pays aime à se reconnaître se décompose. La tragédie du peuple s’affirme petit à petit avec la tragédie des samouraïs.
Avec la restauration des Meiji, l’Empereur met fin aux fonctions des shoguns, les chefs d’armée. En janvier 1873, une loi instaure la conscription et une armée nationale irradiant de cette manière les vertus de dévouement, de loyauté, de discipline, et de sacrifice qui étaient l’apanage des samouraïs. En octobre 1876, les samouraïs de Kumamoto dans l’île de Kyûshû se révoltent contre une garnison de l’armée et inspirent Mishima pour Chevaux échappés qu’il présente comme une tragédie.
L’identification au tragique rejoindrait la néantisation du signifiant relatée par Lacan dans Les psychoses. Par la forclusion, le sujet psychotique serait comme le bushi décrit plus haut, en quelque sorte pris dans l’impossibilité d’assumer la réalisation du signifiant père au niveau symbolique. Seule lui reste l’image à laquelle se réduit la fonction paternelle, une esquisse de mise en scène déchue par forclusion. En d’autres termes, le sujet disparaît par la fenêtre ouverte sur le réel en la demeure du signifiant, en se fixant au-dehors, sur un paysage fantasmatique, perspective idéale.
De l’époque où le jeune Mishima se masturbait devant l’image du martyre de St Sébastien (autour de 1937) – il jouit d’une image, ça le fait tenir – jusqu’au jour où il se fait photographier en St Sébastien (1966) [14] – il jouit de sa propre image par le regard de l’Autre – l’envers et l’endroit du signifiant sont sollicités tour à tour. Dans le premier cas, lecteur, il jouit de l’image d’une tragédie et nous devons y voir le pouvoir de la compensation imaginaire ; tandis que, dans le second cas, écrivain du corps, il jouit de sa propre tragédie de l’autre côté de la contemplation. Mishima touche au réel de la matérialité signifiante.
La figure de l’ange solidifie deux éléments opposés entre eux, elle relaye la lettre dans ce qu’elle maintient au niveau du corps, mais aussi à l’inverse, l’identification à la tragédie de l’ange-martyre lui ouvre la voie vers une jouissance perdue, jusque-là évitée par le semblant de la lettre. La représentation de cette chair complètement immaculée [15] révèle l’oblitération d’un manque qui devrait être déterminée par l’interdit du père sur le corps de la mère. Or, pour Mishima la loi ne se pose pas par le père mais par sa grand-mère Natsuko.
L’interdit qu’elle pose sur la mère n’est pas sans effet car elle prétend ainsi détenir l’objet du désir transmis de génération en génération [16]. C’est un phallus troué qui répond de la virilité bafouée du père et amène Mishima à supporter un déni de la castration par l’image parfaite, sans tâche de péché, d’un corps outragé. Et c’est de ce lieu que la chair immaculée de St Sébastien vient suppléer le trou dans la loi du père.
Le père est supposé être celui qui possède la mère et qui maintient avec l’autre terme de la relation, le fils, un rapport non pas de rivalité mais de pacte. Or pour Mishima, père et mère ne peuvent tenir leurs places symboliques sous la censure de la grand-mère paternelle. En ce sens l’image de St Sébastien vient supporter ce pacte insoluble, elle restaure le symbolique par le voile imaginaire. Un masque est posé sur la mort du sujet, sur sa propre origine. D’ailleurs, aux XIVe et XVe siècles, cette image fut plébiscitée par les dévots pour apaiser leurs angoisses quotidiennes quant à la peste. La splendeur de la chair ressuscitée tient en échec la maladie et triomphe de la mort : « Quiconque meurt glorieusement par la foi et la vérité, conjure la mort » (St Thomas d’Aquin, 1990).
Si les flèches apparaissent comme les signifiants de la mort en concourant toutes vers ce corps plein de vie, elles sont aussi une métaphore du regard et désignent ce corps comme ne pouvant être désiré que par le biais du tragique :
Le trait du regard fait mouche sur la chair adorable. Le sens de la flèche indique l’orientation de la visée perspective, et le corps criblé de flèches devient un pôle où convergent les désirs.
(Darriulat, 1998, p. 201)
Mishima ne s’abstient pas de jouir de la beauté de cette image. Il est au comble de la concupiscence du voir et du savoir, l’image lui donne accès au lieu de l’Autre. Il ne jouit pas de son organe, c’est son sexe qui jouit de son corps être-ange :
La partie monstrueuse de ma personne qui était prête à éclater attendait que j’en fisse usage, avec une ardeur jusqu’alors inconnue, me reprochant mon ignorance, haletant d’indignation. Mes mains, tout à fait inconsciemment, commencèrent un geste qu’on ne leur avait jamais enseigné. Je sentis un je ne sais quoi secret et radieux bondir rapidement à l’attaque, venu d’au-delà de moi. Soudain la chose jaillit, apportant un enivrement aveuglant.
(Mishima, 1983, p. 44)
L’image fait tenir un corps-phallus mais le corps tressaille tout de même du fait qu’il soit étranger à cette virilité qui n’est que surface. Cette image soutient ici le défaut de l’adresse symbolique. De la même façon l’incarnation de ce corps, la représentation de la chair, garantit à l’écrivain l’existence du réel qui demeure la cause d’un invisible. L’invisible se fait voir.
Jusqu’au jour de sa ningen sengen [17], l’Empereur faisait sans aucun doute office d’image suppléante pour Mishima. L’écriture d’un texte sur l’image de St Sébastien au lendemain de la guerre lui donne la possibilité de substituer une autre image à celle de l’Empereur qui ne pouvait plus remplir sa fonction – une possibilité d’effacer l’absence d’harmonie. Mishima jouit de cet être-ange, de la position féminine prise dans sa signification symbolique essentielle, donc finalement mise en corrélation avec la paternité.
Il jouit de cette étrangeté totale représentée par la mère. Sa mère est étrange, elle est interdite non pas par le père, absent et sans pouvoir, mais par sa grand-mère, détentrice de l’éthique samouraï. Il y est question d’un phallus troué car ce signifiant c’est la mort. Toute la vigueur du phallus à étayer sa fonction de voile est réduite à néant, puisqu’à quoi peut bien servir de couvrir l’absence d’un manque ?
Dans un tel schéma, l’objet suppléant favori et idéal est l’image de la mère en tant qu’elle présente au sujet le lieu de l’Autre barré où s’institue le manque de part son inaccessibilité, son impuissance quant à contenir le désir de son enfant. Elle incarne peut-être aussi une forme de l’Empereur qui, au sommet de la hiérarchie, est privé de tout pouvoir effectif.
Il est possible que derrière la question que se pose Mishima, suite à la ningen sengen de l’Empereur – « Pourquoi faut-il que l’Empereur soit devenu un homme ? » (Stokes, 1985, p. 242) – se cache une autre question : pourquoi n’est-il pas resté une femme ? [18] Dans ce cas de figure nous serions au plus profond du trou du symbolique et l’être-ange ne pourrait plus tenir sa promesse compensatrice.
Du reste…
La force virile masculine est tout de même présente dans la représentation de St Sébastien, seulement elle n’apparaît qu’au travers d’un héroïsme déprécié, à la source duquel s’abreuve l’ultime action de Mishima.
En 1966, l’écrivain franchit le pas, il pose en St Sébastien. Il devient enfin lettre-ange, la tragédie est en route. La photographie est identique, trait pour trait, à celle de St Sébastien qu’il décrit dans Confession d’un masque [19] presque vingt ans auparavant.
Attaché contre un arbre – peut-être le signifiant de la puissance guerrière, survalorisé et enraciné par l’interdit de sa grand-mère – il ne peut s’élever, tel un ange vers ce lieu tabou que fixe son regard. L’omnipotence du regard de Natsuko qui le désire à la fois du lieu de la mort et de la loi, le traverse de part en part. Le regard de l’Autre le cloue dans une contemplation narcissique et initialise du même coup un double mouvement pour la pulsion intra/extra corpus.
L’amour de soi-même est la seule issue pour qui n’a pas éprouvé au commencement la loi du signifiant où la division fondamentale se règle pour le sujet avec un père, celui qui extirpe l’infans de sa première enveloppe narcissique au-delà des réminiscences hallucinatoires placentaires de l’origine. Le maître mot du corps mishimien est à lire à la fois dans le sens d’une communion avec l’Autre et d’une excommunication de son ego du champ social : « Tu es moi ! ». Avec le seppuku, Mishima donne un nom à son corps pour lequel se signale la possibilité d’un dédoublement salvateur.
L’écrivain touche à la vérité du signifiant, un savoir s’écrit pour ce qui du logos doit demeurer indicible – une lecture par-delà la luminance, une écriture exempte de lecteurs. Il restaure pour un moment ce qui autrefois faisait bouchon en la qualité absolument inabordable de l’Empereur. L’inscription symbolique se réalise par une image sans consistance pour la matière corporelle, image sacrificielle et perverse dédiée à une esthétique parfaitement tragique, hommage, certes paradoxal, rendu à la vie, à la fuite du temps, par une lettre qui ne pouvait manquer d’être assassine puisqu’elle a laissé une trace par-delà la surface du corps, par-delà les limites du possible.
« Sur le chemin de la sincérité » [20], telle aura été la devise de Mishima. Une sincérité astreinte à l’expérience sensible et déchirante pour le corps de l’auteur, acte intègre quant à l’offense supposée faîte par le peuple insulaire à l’encontre de l’Empereur, provocation offerte à ses compatriotes « déculturés » et au reste du monde.
À la lumière freudienne, le cas Schreber illustre aussi, nous semble-t-il, cette culpabilité inculquée par la langue et constitutive de l’identité subjective. Sa Nervensprache le marginalise en tant qu’élu de Dieu, le seul à pouvoir saisir la douleur divine, le seul et l’unique à pouvoir racheter les fautes de l’humanité. Il peut donc à sa manière, à la condition de devenir femme, personnifié l’origine du monde par l’écriture d’un mythe.
On découvre ce pousse-à-la-femme chez Mishima, mais le montage fantasmatique prend une tout autre tournure. La contemplation mythologique dans laquelle l’écrivain s’est réfugié apparaît comme un mensonge au lendemain de la guerre, le régime occidental révèle l’imposture du mythe originaire d’Amaterasu transmise par la lettre depuis la nuit des temps. À la figure féminine mythologique, l’Autre absolu, s’apparente un doute quant au semblant du discours impérial. Le père suppléant renonçant au statut divin, le réel l’appelant ainsi inéluctablement, Mishima n’eut pas d’autres choix que de suivre le chemin tracé par la tradition japonaise pour pallier au constat inacceptable pour le Moi d’une dépendance radicale à l’Unheimlich [21], à savoir l’aveu d’une virilité répudiée par la désillusion d’un mythe dépourvu de sens.
Sources bibliographiques
Assoun, P-L. (1989). La bête et l’ange : fantasme et écriture chez Mishima, De l’ange ou comment le fixer. Cahiers de psychologie de l’art et de la culture, n° 15, p.. 91-101.
Bataille, G. (1970). Œuvres Complètes, tome I, La mutilation sacrificielle. NRF Gallimard.
Chemama, R (sous la direction de). (1998). Dictionnaire de la psychanalyse, dictionnaire actuel des signifiants, concepts et mathèmes de la psychanalyse. Larousse.
Cecchi, A. (1999). Mishima Yukio, esthétique classique, univers tragique. D’Apollon et Dionysos à Sade et Bataille. Honoré Champion éditeur.
Char, R. (1962). Fureur et mystère. Gallimard.
Darriulat, J. (1998). Sébastien, le renaissant. Éditions de la lagune.
Doï, T. (1982). Le Jeu de l’indulgence. Coédition Le Sycomore et l’Asiathèque.
Freud, S. (2002). L’inquiétante étrangeté et autres essais. Gallimard.
Groupe franco-japonais du champ freudien (sous la direction de). (1988). Lacan et la chose japonaise, Navarin.
Héritier, F. (1996). Masuculin-Féminin : la pensée de la différence. Odile Jacob.
Kundera, M. (1995). L’art du roman. Gallimard.
Lacan, J. (1966). Table ronde sur la place de la psychanalyse dans la médecine. Cahiers du collège de médecine des hôpitaux de Paris, n° 12, p.. 761-774.
Lacan, J. (1981). Le Séminaire, Livre III, Les psychoses, séance du 11 avril 1956. Le Seuil.
Mishima, Y. (1966). Le livre de la sagesse anti-chaste, non-traduit.
Mishima, Y. & Domoto, M. (1966). Yukoku / The Rite of Love and Death. An Evergreen Film.
Mishima, Y. (2001). Patriotisme. Dojoji et autres nouvelles. Collection Folio. Gallimard.
Mishima, Y. (1983). Confession d’un masque. Gallimard.
Mishima, Y. (2004). La Mer de la Fertilité : Neige de Printemps, Chevaux échappés, Le Temple de l’Aube, L’Ange en décomposition. Quarto Gallimard.
Pinguet, M. (1984). La mort volontaire au Japon. Gallimard.
Ricœur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Le Seuil.
St Thomas d’Aquin. (1990). La Cité de Dieu, Somme théologique. Les éditions du Cerf.
Soler, C. (1999). Joyce, le fils nécessaire, L’aventure littéraire ou la psychose inspirée. Éd. Champ lacanien, p.. 59-73.
Stokes, H.S. (1985). Mort et vie de Mishima. Balland.
Yamamoto, J. (1999). Hagakuré, le livre secret des samouraïs. Guy Tédaniel éditeur.