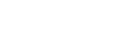Il y a toujours chez le sujet quelque chose qui résiste à la notion d’arbitraire du signe. Il lui est difficile d’accepter que la lettre, le signe, le son proféré, puissent être dénués de signification, voire, que le mot soit sans rapport nécessaire à la chose. Grande question, commune, en fait, à bien des civilisations, qui ont toutes avidement interrogé ce lien. L’observation de l’écriture chinoise ne laisse pas d’être instructive à cet égard. Loin de reposer sur des bases exotiques, inouïes, elle laisse bien voir certaines des préoccupations qui sont celles de tout sujet humain lorsqu’il est confronté à la question de l’écrit, et ceci quelle que soit sa culture.
Une des difficultés, avec l’écriture chinoise, est la prégnance des préjugés et des conceptions fausses dont elle est entourée. Et pas seulement de la part de ceux qui ne la connaissent pas : les Chinois eux-mêmes, et les sinologues tout autant, les reçoivent et les transmettent fidèlement. Plus difficile encore, si ces préjugés, si ces conceptions fausses doivent d’être écartés, ils contiennent aussi une part de bien-fondé, laquelle mérite attention. Cette part de fiction associée à une part de vérité est précisément le cocktail qui est situé au cœur de la question qui nous occupe ici : à savoir, que le sujet ne peut se résoudre à ce que le signe linguistique soit purement de l’ordre de l’arbitraire.
Le mieux est de passer par des exemples.
On parle souvent, à propos des « sinogrammes » (les signes de l’écriture chinoise), en termes d’« idéogrammes ». Cette expression renverrait à une relation directe entre le signe écrit et les référents extérieurs, ou entre le signe et les idées. Il ne renverrait donc pas nécessairement à un référent proprement linguistique. De fait de tels sinogrammes existent, et sont nombreux, depuis la « tablette » 几, avec ses pieds et son plateau horizontal, jusqu’au « cheval » 馬, caractère moderne où se reconnaissent encore les pattes et la crinière héritées de pictogrammes archaïques que le temps a stylisés :






Cette réalité fait illusion. Elle en masque une autre, statistiquement beaucoup plus massive : le fait que, comme toute écriture au monde, et ceci dès ses origines mêmes, l’écriture chinoise a reconnu sa valeur de représentant des sons de la langue, et a donc joué pleinement son rôle de signe proprement linguistique. Plus on remonte dans le temps, vers l’origine de l’écriture chinoise, plus on rencontre de preuves de la découverte précoce, par ses premiers scripteurs, des propriétés phonétiques de l’écriture. Ces propriétés ont organisé les graphies. Par exemple, si la série suivante de caractères : 有, 右, 佑, 佑, 侑, 祐 présente un élément commun (ナ), ces caractères partagent aussi la même prononciation : you. On a pu établir qu’à l’origine (c’est-à-dire aux xive siècle xiie siècle AC) l’élément graphique ナ a représenté la syllabe aujourd’hui prononcée you (et, alors, hypothétiquement prononcée *wə-ʔ/*wə(-k)-s). Pour correspondre à des significations différentes, ces caractères homophones ont été obtenus par des diversifications graphiques effectuées, au cours du temps, à partir de ce premier élément graphique ナ : mais ils en ont tous conservé la trace, comme marqueur phonologique.
Ceci revient-il à dire que les caractères chinois obéiraient à un simple système phonétique – organisé, en l’occurrence, à la manière du japonais, en un syllabaire ? La réponse est qu’il s’agit bien d’un système de signes syllabiques, mais qu’ils ne répondent pourtant pas cependant à une logique à 100 % phonétique. Du sémantisme entre comme composante discriminatoire dans les graphies.
Illustrons ceci d’un autre exemple.
Comme dans toutes les langues, le chinois possède un lexique où les mots vont par « grappes ». Ils sont dérivés les uns des autres, et l’étymologie permet de reconnaître leurs liens (ex : « testament » / « détester »). Des diversifications sémantiques se sont opérées à partir de sens originels. Ainsi prenons un phonème, aujourd’hui prononcé nong, qui a pour sens premier celui de « dense », « épais », « fort ». Graphié

sous sa forme archaïque, il a évolué, plus tard, vers la graphie 農 encore en usage aujourd’hui. Accompagnant les spécifications particulières de la notion de « dense » en de nombreuses sous-significations de ce premier terme, des graphies se sont également multipliées, mais toutes s’organisant autour de ce graphème 農 porteur de prononciation. Ainsi :
濃, « rosée abondante »
襛, « vêtements épais »
欁/檂/穠, « végétation dense »
醲, « alcool fort »
噥, « saveur prononcée »
癑, « pus »
鬞, « chevelure en broussaille »
齈, « hypersécrétion nasale », « catarrhe »
Dans cette série, les différentes connotations d’un même phonème – ici monosyllabique, s’agissant du chinois – sont différenciées graphiquement, l’écrit permettant de lever les équivoques de la langue : des éléments graphiques surajoutés à 農 permettent de discerner à quel sens particulier de la même syllabe nong nous avons affaire. Le rôle de l’écriture dans la désambiguïsation lexicale est universel : mais là où les écritures alphabétiques recourent à des ressources orthographiques (« soit » / « soi » / « soie », « curry » / « curie »), en chinois les éléments différenciateurs sont sémantiques. Dans la série ci-dessus, il est facile de repérer dans sa logique le lien existant entre chaque caractère et sa signification, par le biais de la « clé » graphique qui lui est accolée : respectivement « clé » de l’ « eau » 氵, du « vêtement » 衤, du « bois » 木 ou des « graminées » / « céréales » 禾, des « boissons fermentées » 酉, de la « bouche » 口, de la « maladie » 疒, de la « chevelure » 髟, du « nez » 鼻…
Il ne s’agit pas, avec le chinois, de deviner, mais bien de repérer quelque chose du sémantisme. Or ce lien suffit en fait amplement pour satisfaire l’appétit de tout sujet humain en faveur de l’idée selon laquelle le rapport entre signe et sens ne sera pas complètement arbitraire. C’est ainsi que l’écriture du chinois a toujours conservé un certain rapport à la signification, fût-il vague, même lorsqu’elle a été de fait organisée par le phonétisme de la langue, dont il est désormais établi que ses premiers scripteurs, dès les origines, ont eu conscience. Des « clés » graphiques comme celles qu’on vient d’énumérer, et des dizaines d’autres, se sont retrouvées associées à d’autres dizaines d’éléments porteurs de valeur phonétique, permettant une multiplication aisée, relativement logique, tout à fait gérable pour une mémoire ordinaire, des sinogrammes. C’est ainsi que s’est constituée la catégorie, totalement dominante puisqu’elle correspond environ à 90 % du stock des caractères, de ce que les chinois appellent les xingshengzi 形聲字, les caractères combinant un élément sémantique (xing 形) avec un élément indicateur de sa prononciation (sheng 聲).
Et c’est sans avoir eu besoin du tout que les caractères d’écriture « représentent » ou « symbolisent » les choses, mais au contraire en prenant en compte le phonétisme de la langue, que l’écriture du chinois est arrivée à ce résultat original et extrêmement paradoxal, d’avoir généré un répertoire immense de « logogrammes », c’est-à-dire de signes d’écriture correspondant chacun à des mots de la langue, et non à une écriture alphabétique de nature purement phonétique. Le stock des caractères chinois a vu historiquement son nombre croître de façon exponentielle, et pourtant ces caractères ne sont, dans leur majorité écrasante, ni des « dessins » ni des « rébus ».
Or c’est ce point qui est crucial, car on peut se demander si ce n’est pas cet avantage subjectif d’un repérage possible de la signification dans le signe graphique, au lieu que ce dernier soit purement différentiel, qui a fait que les Chinois ont opté, dans leur histoire, pour un système graphique aussi encombré, au lieu de céder, comme l’on fait la plupart des peuples, vers la simplification radicale que représentait la constitution d’un système de signes purement phonétiques. La lettre correspond à un effondrement de la représentation dans le champ de l’écriture. Le Chinois a maintenu ce lien. Or il est important de souligner, à partir de cet exemple chinois, que pour ce lien existe, il n’est pas du tout nécessaire qu’il y ait à proprement parler ressemblance. C’est exactement ce dont parle Lacan dans L’Identification, à propos de la fonction du signifiant (qu’il distingue du signe), quand il évoque, à propos du trait unaire, ceci, qu’« en tant que ce qui le distingue ce n’est point une identité de semblance » : pour un signifiant, nous explique-t-il, la différence n’est pas fondée ou non sur la « ressemblance », mais sur le fait « que le rapport du signe à la chose soit effacé » (séance du 6 décembre 1961). L’einziger Zug est en effet une notion importante ici : il nous permet d’appréhender comment c’est à travers son absence que l’objet compte, de par son effacement par l’intermédiaire du marquage du trait.
L’écriture chinoise s’est bien organisée à partir d’une présence de la chose qui réside dans son effacement même. C’est ce que fossilise en quelque sorte l’élément « sémantique » de graphèmes qui sont par ailleurs chargés comme on l’a dit d’une valeur phonétique. De cet effacement, on peut dire que l’acte calligraphique, où le corps est engagé, a été, dans la tradition culturelle chinoise, l’une des mises en scène privilégiées. Il répète à l’envi cet acte de représentation, mais d’une représentation qui est présente seulement à travers son refoulement. Car si par la calligraphie les objets du monde prennent corps, ça n’est pas par la ressemblance. En effet, si le calligraphe peut encore s’arranger pour figurer les sinuosités d’un dragon dans le caractère du « dragon » 龍, à quel titre peut-on dire – comme le fait classiquement la critique traditionnelle – que tel calligraphe aura su nous faire voir le « loriot » à travers le caractère du « loriot » : 鶯 ? Du point de vue de la forme, ce caractère n’a aucune chance de ressembler à ce volatile, composé qu’il est de la clé de l’ « oiseau » 鳥 assorti d’un élément apportant son phonétisme et commun à bien d’autres caractères prononcés ying comme lui, et signifiant tout autre chose : 營, 瑩, 縈, 熒… Pourtant c’est bien ce que l’on dira : le caractère rend présente la chose ; le signe graphique ne serait ainsi rien moins qu’arbitraire. La critique chinoise traditionnelle sur la calligraphie – dont les origines, il faut le rappeler, ont des liens avec les milieux des magiciens taoïstes – nous montre que nous sommes dans tout autre chose que le registre simplement esthétique de la calli-graphie (de la « belle écriture »).
Rapport du signe à la chose effacé, mais non aboli. L’écriture chinoise a pu ainsi se donner une représentation d’elle-même très originale, comparativement au discours que les civilisations à écritures alphabétiques ont tenu sur la lettre. Elle a pu maintenir cette idée, que du signe à la chose, il y a toujours un lien présent. Comme les caractères se sont multipliés par milliers, cette multiplication des graphies a été vue comme un reflet de la multiplicité des choses du monde. C’est à ce titre que l’écriture a été engagée dans tout un discours où elle a été vue rien de moins que comme un support du ciel. Tel est le sens par exemple du travail de Xu Shen 許慎, auteur du Shuowen jiezi 說文解字, ou Discours sur les caractères simples et explications sur les caractères composés, au ie siècle de notre ère. Dans ce qui fut le premier véritable « dictionnaire » raisonné des caractères chinois, à côté d’une analyse de leur phonétisme tout à fait consciente de leur lien avec la langue et la prononciation, l’auteur inscrivait l’écriture dans un vaste système cosmique, avec lequel cette écriture entretenait un réseau serré de correspondances symboliques, ce qui avait pour résultat de lui faire dépasser complètement l’ordre du langage. C’est de l’observation des signes présents dans le monde que les Sages anciens avaient tiré, par imitation, les signes écrits : ainsi soutint la tradition dont Xu Shen fut l’un des plus importants représentants. Cette théorie de l’écriture permit une lecture globale du monde : le monde entier eut sa correspondance dans l’univers des tracés. Comme le formule la sinologue Françoise Bottéro : « À l’époque des Han, l’écriture note bien la parole, chose naturelle en soi, mais elle ne représente pas moins un système de signes visuels détachés du contexte de la langue parlée. Dans la perspective de Xu Shen (et celle de ses contemporains), c’est toutefois le système dans lequel les signes graphiques sont vus comme des “dessins naturels et spontanés” qui est le plus valorisé, du fait qu’il s’inscrit dans une tradition de lecture du monde, supposée être à la base de l’invention de l’écriture ».
Le Shuowen jiezi a été immensément influent : d’une certaine façon, il est à l’origine de toute une tradition de discours sur l’écriture qui fait dire, aujourd’hui encore, que les signes chinois sont « idéographiques », reléguant au second plan leur rapport pourtant primordial avec la langue.
Alors que, comme nous l’avons esquissé, les caractères chinois qui relèvent de la figuration (pictographique, idéographique) sont l’exception et non la règle au sein du vaste ensemble des sinogrammes, cette fascination pour l’idée selon laquelle l’univers des signes est en rapport avec le monde a été durable. Elle a encouragé, au-delà d’une réflexion sur les graphèmes eux-mêmes, une immense littérature critique qui a fait de la création littéraire dans son ensemble quelque chose qui engageait l’univers tout entier. Ainsi dira, écrivant au vie siècle, Liu Xie 劉勰, dans l’un des plus importants traités que la critique littéraire chinoise nous ait légués, le Wenxin diaolong 文心雕龍, Le Cœur de la littérature et la sculpture des dragons :
L’origine du wen humain [i.e., des textes écrits] se trouve dans l’Extrémité suprême [i.e., l’interaction du yin et du yang]
Manifestant dans son intime profondeur l’Efficience infinie à l’œuvre dans l’univers. […]
Confucius paracheva [les commentaires du classique de la divination, le Yijing, ou Classique des mutations] :
Que les propos aient un caractère wen [riche de portée littéraire], et ils sont naturellement l’esprit du Ciel et de la Terre.
[…] les tablettes de jade aux inscriptions d'or ainsi que la floraison des lamelles vertes écrites en teinte de cinabre, à qui en attribuer la responsabilité [en tant qu’auteur] ?
Tout cela n’est que le résultat de l’ordonnance interne émanant de l’Efficience [cosmique].
On a pu dire que des conceptions telles que celles-ci, étaient typiques de leur époque, c’est-à-dire de contextes où les dynasties, en encourageant un discours de mythification de l’écriture, construisaient leur légitimité politique en la faisant reposer sur l’ordre de la nature. Du point de vue historique, cela a été une condition certainement nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Les raisons de cette « mythification » ne sont pas seulement externes, en l’occurrence de l’ordre de la fabrication d’un discours cosmologico-politique. Elles sont, à mon sens, internes au système graphique lui-même, et tout spécialement à cause de cet aspect que nous avons évoqué, à savoir cet acte de représentation réalisé à travers l’effacement. Constitués à 90 % de caractères « idéophonographiques » (traduction possible pour l’expression xingshengzi citée plus haut), où le phonétisme est présent, mais où est présent aussi, quoique sous une forme à peine esquissée, quelque chose d’un sens qui va directement du signe graphique aux objets du monde sans passer par la langue, le système graphique du chinois repose sur une référence linguistique qui se ménage par ailleurs l’économie de ce renoncement, coûteux pour le sujet, que constitue le constat de l’arbitraire du signe.
Il y a là un surplus de jouissance que l’on retrouve partout, en Chine, autour de l’écriture nationale et des jubilations auxquelles elle donne lieu, depuis l’art calligraphique jusqu’aux étymologies fantaisistes dont les manuels élémentaires de chinois, ou les livres destinés à faciliter aux enfants l’apprentissage de l’écriture, sont remplis. Qu’il est bon de penser que le caractère de l’ « homme » 男 ferait voir les pectoraux saillants dudit et ses deux jambes marchant d’un pas bien décidé ! Ou de croire que la « mer » 海 est la « mère » 母 de l’ « eau » 氵! Qu’il est utile à la fiction d’un empire naturellement pacifique harmonieux (!) de laisser croire que les « armes » 武 ne doivent être que des instruments servant à « mettre un terme » 止, précisément, à l’usage des « armes » 弋 ! Ces étymologies ou interprétations sont fausses, mais elles sont goûtées, parce qu’elles offrent bien plus que des ressources mnémotechniques : elles permettent de défier sans cesse cet arbitraire du signe auquel le sujet ne peut se résoudre.
Dans Naissance et renaissance de l’écriture, Gérard Pommier écrit : « Dessiner une forme reste, pour l’être humain, un exploit, si la propre représentation de son corps lui échappe au moment du refoulement. Tout graphisme évoquera cette perte première et son tracé inaugure un mouvement de reconquête qui le laissera tremblant. Si l’on peut rappeler, après nombre d’épigraphistes, que l’écriture progresse du pictogramme au phonogramme selon un procès d’effacement de l’image derrière la sonorité que les dessins évoquent, ce cheminement reproduit celui du refoulement qui, lui aussi, efface la signification de l’image du corps. » Écrire en chinois, c’est en quelque sorte renouveler infatigablement cette dramaturgie de l’effacement, qui est aussi celle de la mise en présence.